 |
|
|
|
Ses personnages, qu’ils appartiennent à
l’univers des westerns ou à celui de la fiction, sont la rencontre
géométrique de l’opiniâtreté et d’un individualisme exacerbé.
Ils sont la plupart du temps de mauvais garçons, des rebelles,
des produits d’une société violente, qui refusent tout bien-être
social qui les priverait de leur propre dignité et de leur
sens de l’honneur. L’individualisme est dichotomique :
au sens noble du terme, il prend son essor dans la philosophie
transcendantale du XIXe siècle, et permet une perpétuelle
remise en cause, valorise l’individu et néglige la globalité
sociale ; ainsi, dans Cross of Iron (1977), Steiner,
un officier allemand, décide de désobéir aux ordres de son
supérieur qui vont à l’encontre de ses convictions, c’est
là son individualisme qui glorifie le libre choix. Le deuxième
sens prend forme dans la société qu’il décrit, où la seule
façon de survivre est, de prime abord, de penser à soi. L’individualisme
exacerbé se caractérise par le vol, l’obsession de l’argent
qui sont le reflet des errances du monde contemporain. Toutefois,
il reste élégiaque pour ceux qui vivent selon leur propre
morale ; ses personnages, Pike Bishop, Bennie d’Alfredo
Garcia (1974), Junior Bonner, sont complexes, contradictoires,
désenchantés et perdus dans un monde en mouvement (1).
Les gestes de l’homme sont disséqués et mesurés par un auteur
qui avoue : « je fais toujours passer les personnages
avant l’action » (2), et les place devant certaines situations,
pour étudier leurs comportements, leurs réactions, leurs évolutions,
leurs désirs.
| |
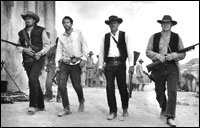 |
|
|
Bloody Sam présente toujours un ou plusieurs
individus centraux en proie à un grave dilemme moral, spirituel
ou existentiel, dont la résolution va déterminer le reste
de leur vie. C’est bien ici la quintessence du travail de
Peckinpah. Ces anti-héros évoluent dans un microcosme où l’existence
humaine ne vaut pas cher, et ils ont à un moment l’opportunité
d’agir selon leur conscience. Comme le souligne François Causse
à propos de l’engagement des hors-la-loi de The Wild Bunch :
« l’engagement d’Angel souligne de surcroît la contradiction
majeure de la horde : le comportement intéressé et immoral
de ces criminels n’empêche pas l’affirmation d’une éthique ».
Pour ces derniers, retourner chercher Angel marque le retour
de la horde à une certaine intégrité morale, ils mettent ainsi
leurs actes en conformité avec leurs paroles. La scène mythique
où la horde marche vers le camp traduit bien cette prise de
conscience qui s’effectue dans un ultime revirement surprenant.
Ces hommes, obsédés par l’argent facile, prennent à un moment
l’initiative de faire machine arrière pour se sacrifier par
amitié : « Il faut qu’on reste ensemble. Si
on abandonne ses amis, on n’est plus des hommes, on est comme
des animaux ». Cette réplique de Bishop qualifie à merveille
le héros Peckinpien. Indubitablement le dernier combat, s’il
est toujours désintéressé, presque christique, va toujours
à l’encontre de leur ‘capital culturel’. Ces personnages,
plutôt mauvais, sont capables d’effectuer un geste désintéressé,
gratuit. Dès lors, ils abandonnent leur syncrétisme idéologique
pour adopter un but commun. Pour Sartre, le groupe incarne
le projet historique libre, la praxis représente dans cette
perspective un projet organisateur, commun, où les différentes
consciences s’efforcent ensemble d’atteindre leur objectif.
Ce projet collectif est synthétisé par le plan large du quatuor
de The Wild Bunch qui s’avance vers le général Mapache.
La décision de tout abandonner, de donner sa vie, sous-tend
aussi une lutte implacable contre un système oppressif. Ces
personnages sont des héros condamnés, en butte à la corruption
du monde. La violence est souvent associée à l’Etat, c’est
un propos récurrent dans son œuvre ; l’oppression institutionnelle
prend différentes formes, dans Ride the High Country
(1961), pour rendre l’union caduque et dénouer cette terreur
officielle, Gil Westrum se tient derrière le juge, le menace
de mort pour qu’il déclare l’annulation du mariage. Pour les
différents personnages, la révolte contre la tyrannie du pouvoir
semble indissociable de leur esprit de sacrifice. Pourquoi
Bennie choisit-il de mener jusqu’au bout la poursuite de la
vérité ? Au moment où il a le choix de renoncer, il choisit
de laisser s’exprimer sa fureur meurtrière ! Tuant ses
commanditaires, remontant jusqu’au chef lui-même qui s’exclame :
« Bring me the head of Alfredo Garcia ! ».
Dans ces films, Peckinpah décortique la collusion du pouvoir
politique et économique, et dénonce la corruption des représentants
de la ploutocratie : despotes dépravés et suintants (The
Wild Bunch), des êtres dégénérés (Bring me the Head
of Alfredo Garcia), des représentants du gouvernement
sans scrupule (Ride the High Country & Pat
Garrett). Ainsi même l’homme qui terrassa Billy the Kid,
s’oppose à la fin de sa vie au pouvoir du gouverneur en refusant
de laisser les troupeaux paître sur ses terres, ce qui provoquera
son assassinat.
|