Déjà très à l’aise en groom ou en cantinière, le Noir se voit
confier par Hollywood un nouveau rôle de composition dans les
« Tarzan » de la MGM dès 1932 : chair à lions
et à crocodiles. Un boubou, deux os dans le nez et quelques
plumes font d’un figurant de la Louisiane un y’a bon sauvage.
Planté dans sa fausse jungle, il devient l’incarnation révoltante
du dédain américain pour l’Afrique. |
|
....................................................................
|
|
Tous les regards se tournent naturellement
vers Tarzan, grand singe albinos, voltigeant de liane en liane.
Ce corps laiteux, équarri presque, retient l’œil au point
de plonger dans l’ombre le cuir tanné des indigènes. Animaux
homochromiques, les voilà se fondre si bien dans l’épaisse
toison équatoriale. Si bien que personne ne se souvient de
la réduction dont ils sont victimes. Par le raccourci et la
caricature, les responsables de ces films rabaissent une civilisation
séculaire aux expressions simples de la sauvagerie et de l’hébétude.
Le Noir est donc soit un cannibale aux penchants gloutons,
soit un porteur servile, chevilles marquées par les fers de
la sujétion.
La reconnaissance de la culture noire est
pourtant manifeste depuis le début du siècle. La clarinette
de Sidney Bechet ou les jambes effilées de Joséphine Baker
exercent une fascination qui bouleverse l’échiquier de la
musique et de la danse. L’Art Nègre souffle son mystère et
inspire le mouvement cubiste. De nombreux ethnologues, Maurice
Delafosse, Marcel Mauss ou Lucien Lévy-Bruhl, admettent l’identité
forte d’une culture, et, par récognition, déterminent la grande
notion d ’ « Africanisme ».
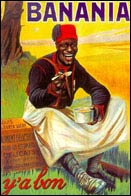 |
|
|
|
Mais un tranquille engourdissement populaire
ne s’annule pas en trois bravos. Depuis des siècles, chacun
clame à qui veut l’entendre la supériorité de l’homme blanc.
Comment, en un air de jazz et deux masques Dogons, raser le
bourrage de crâne appliqué à tous ? Personne, dans les
années 30, ne pouvait réellement s’émouvoir du sort réservé
aux populations africaines représentées. La littérature faubourienne,
la publicité, les cartes postales, les calendriers, concouraient
avec le plus grand naturel à entretenir l’esprit du « Y’a
bon Banania ». Infusé d’un tel poison idéologique, le
spectateur moyen dérange sa contention, durant la projection,
de quelques éclats de rire pendant les scènes où le fouet
fait son travail. Le seau de popcorns entre les genoux, il
se laisse glisser dans les crevasses de cette terre hostile.
Il veut son quota de sexe et de sauvagerie, son assiettée
de chimpanzés, de mygales et de méchants anthropophages. La
fantaisie d’un plaidoyer viendrait troubler sa digestion.
Le succès de la série des Tarzan confirme
la médiocre nécessité du public d’assister à un spectacle
attendu, enfilant les poncifs comme des perles. Le dépaysement
grossier est sans doute un miel qui adoucit les maladresses
les plus obscènes, les racismes les plus ordinaires.
De Tarzan the ape man (Woody S. Van
Dyke, 1932) à Tarzan’s secret treasure (Richard Thorpe,
1941) (1), le scénario suit à peu près toujours
la même ligne : une expédition, composée de baroudeurs
et de candides, traverse des territoires interdits, la convoitise
au bout des fusils. Aveuglés par la cupidité, les prospecteurs
finissent à deux mètres de la cocotte minute, prisonniers
d’une tribu sanguinaire. Tarzan interviendra moins pour sauver
les suppliciés que pour rétablir le calme dans sa jungle.
Son héroïsme ne nous fera cependant pas oublier l’égrappage
patient, monstrueux, pratiqué sur les porteurs, gentilles
fourmis noires ne quittant leur faix qu’une fois les pieds
et les mains bloqués dans l’étrier de la torture.
|