CONCLUSION
| |
 |
|
|
Si Chaplin voyait le burlesque dans
la morale de la tarte à la crème, Buñuel prône l’immoralité
dans le grotesque. Mais ce dernier n’est pas innocent, utilisé
comme arme révolutionnaire du scandale surréaliste, la provocation
calculée reste un appel à l’irrationnel, à l’obscurité,
à toutes les pulsions qui surgissent de notre « moi »
profond. Ce qui reste du surréalisme dans l’histoire de
l’art en passant par la littérature et la peinture, c’est
la découverte d’un conflit difficile et réel entre une certaine
morale bien pensante instituée par la société et notre propre
morale qui relève de l’expérience perceptive et du savoir
encyclopédique de chacun.
Cette dualité montre les limites de la liberté individuelle
et le surréalisme permet de supporter la perfectibilité
humaine sans qu’elle pousse pour autant à son anéantissement :
« Sade ne commettait ses crimes qu’en imagination,
comme une façon de se libérer de ses pulsions meurtrières.
L’imagination peut se permettre toutes les libertés. Passer
à l’acte est autre chose. L’imagination est libre ;
l’homme non. » (16) Chez Buñuel comme chez
Sade, le bien et le mal, qui sont les valeurs manichéennes
du catholicisme, ne peuvent qu’engendrer des êtres immoraux
et surréalistes. En effet, dans Viridiana, l’héroïne
vouée à devenir none, finira sa vie avec le responsable
de l’exploitation de son oncle ; de surcroît, l’exploitant
a déjà une liaison avec la gouvernante. Le film s’achève
sur une partie de carte entre les trois protagonistes masquant
à peine la métaphore de la vie en trio. C’est une variation
de Jules et Jim sans « confusion des sentiments »,
vu le consentement des personnages. Malgré tout, la caricature
naturaliste sévit encore comme une quête de l’homme soulagé
des contraintes sociales. Un chien andalou
et L’Age d’or trahissent le regret d’une certaine
« primitivité » heureuse.
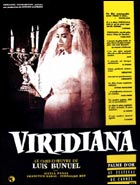 |
|
|
|
Il s’agit de l’humain naturel sorti
tout droit de l’éden originel que Saint-John Perse a décrit
dans ses rêveries surréalistes et poétiques. Ces deux films
sont une apologie paradisiaque de l’amour fou dont on ne
peut se passer : « le surréalisme ne permet pas
à ceux qui s’y adonnent de le délaisser quand il leur plaît.
Tout porte à croire qu’il agit sur l’esprit à la manière
des stupéfiants ; comme eux il crée un certain état
de besoin et peut pousser l’homme à de terribles révoltes. »
(17)
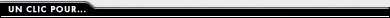 |
|
Gilles Visy, de l’Université
de Limoges, et l'auteur d'une thése,
Le Colonel Chabert au cinéma édité
par les Editions Publibook.
Sujet
: L’adaptation cinématographique
d’une œuvre littéraire nous
fait passer d’un point de vue interprétatif
à un autre, et aboutit à une sorte
de transcodage de l’écriture littéraire.
A partir de l’étude du Colonel Chabert,
écrit par Honoré de Balzac et
adapté au cinéma par René
Le Hénaff en 1943 et par Yves Angelo
en 1994, Gilles Visy s’interroge sur le
rapport complexe qu’entretiennent le texte
et l’image.
A lire
: Télécharger
les 11 premieres page (PDF)
Préfacé de
: Stéphane Vachon (spécialiste
de Balzac)
Post-face de : Yves
Angelo (réalisateur)
Nbr pages : 366 pages
Genre : Recherche
|
|