SYNOPSIS :
Des années 40 au lendemain de la Révolution culturelle, Vivre
! revisite quarante ans d'histoire de la Chine à travers
les destins de Fugui et de sa femme, Jiazhen. |
|
....................................................................
|
|
L’ESPOIR COMME ULTIME RECOURS
| |
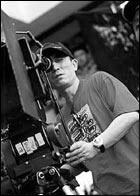 |
|
|
Zhang Yimou est retenu malgré lui
en Chine parce que son film n'a pas encore reçu son visa d'exploitation
de la censure ! L'histoire se passe pendant le Festival de
Cannes en 1994 : son film, Vivre ! y est présenté en
compétition officielle mais le cinéaste ne peut assister à
la projection tant que le film ne bénéficie pas de cette autorisation
officielle accordée par le régime de Pékin. Le cas n'est pas
isolé et illustre bien la situation dans laquelle se trouvent
les réalisateurs chinois qui doivent faire face à une main
mise permanente exercée par la censure aux différentes étapes
de la conception de projets cinématographiques (financement,
distribution, etc.).
Réalisateur emblématique de la « cinquième génération »,
Zhang Yimou est, avec Chen Kaige, le fer de lance du nouveau
cinéma chinois, issu de la Révolution culturelle. Même si
ses films connaissent actuellement un certain succès à l'étranger,
le cinéaste n'est toutefois pas totalement accepté dans son
pays. Il doit subir les critiques conjointes de l' « intelligentsia »
chinoise et des autorités de Pékin qui lui reprochent de mettre
en scène des projets davantage axés sur l'Occident. Avec Vivre
!, il dresse le portrait d'une famille chinoise balayée
par le malheur à travers quarante ans d'Histoire de la Chine,
de la période nationaliste à l'avènement de Mao, en passant
par la Révolution culturelle et la période du « grand
bond en avant ». A l'instar de Fassbinder, Zhang revisite
l'Histoire de son pays, non pas en amont mais en aval. Vivre
! constitue davantage un mélodrame familial qu'un simple
film historique. On y retrouve, en effet, tous les ingrédients
du genre : fatalité, drame, musique empathique, etc. Aux héros
ou aux victimes de la guerre, il préfère l'option de la quotidienneté.
L'Histoire, présente en arrière-fond dans le récit, s'efface
alors au profit des personnages. Ceux-ci ne seraient ni des
victimes (au sens passif du terme), ni des entités historiques
mais des héros anonymes, des témoins du changement de régime
qu'a connu le pays. Zhang ne porte aucune forme de jugement
vis-à-vis de ses personnages et n'éprouve pas non plus de
pitié à leur égard. C'est au spectateur qu'incombera cette
tâche. Si, en chinois, « huozhe » possède la double
signification de vivre et de survivre, ce terme s'applique
aussi bien aux millions de Chinois qui ont dû « survivre »
pendant près d'un demi-siècle pour éviter de s'attirer les
foudres du régime maoïste qu'à la famille de Fugui. Accompagné
de sa femme, Jiazhen, celui-ci traversera les époques et connaîtra
tour à tour les désillusions de la faillite, de la guerre
et le drame de perdre ses enfants. C'est là que le verbe chinois
prend tout son sens. Malgré ses malheurs, le couple continuera
à garder espoir en la vie et en l'avenir. L'usage du point
d'exclamation dans la traduction française du titre indiquerait
non seulement un ordre, un souhait, mais il représenterait
également un exemple pour les nouvelles générations. Le message,
suggéré par l'isotopie du titre, aurait davantage une portée
universelle que proprement chinoise. La dernière réplique
du film illustre parfaitement cet élan optimisme : « la
vie sera de plus en plus belle ». Elle consacre le triomphe
des valeurs humaines, individuelles sur les sentiments collectivistes
prônés par le régime communiste.
|