 |
|
|
|
La première vraie
rencontre entre Bila et Sana est filmée dans le sens d'une
complémentarité : Bila, lui, est placé au bord gauche du cadre.
Sana, elle, est placée au bord droit du cadre. La même image
photographique se fait face, et s'inverse. Et se complémente.
Le reste du temps, les corps souvent placés au précipice ou
fuyant le « champ », indiquent cet Autre sans cesse repoussé,
sans cesse écarté.
Souvent, aussi, un obstacle vient lutter contre l'harmonie
des corps : du feuillage au premier plan, un mur, etc. Bila
et Sana souvent pris en sur-cadrage d'évoquer leur distance,
leur recul, leur prise de position lucide sur cette société
qu'ils observent en silence. Et sans jugement. " Ne la
juge pas " est-il d'ailleurs dit dans Yaaba. « Elle
a peut-être ses raisons ».
Au tour de Yaaba, également, cette brèche réelle dans
la chair de Nopoko lors d'une altercation avec des enfants
du village. Cette coupure au couteau sera le nouvel élément
dramatique du film jusqu'à la fin, il en est le suc. Les rares
gros plans du film, comme des moments de rupture esthétique
violente, traquent ces plaies ouvertes dans la peau des bras
et des visages. Yaaba est cette grand-mère au vieux corps
filmé sans détour. La peau, « le profond ».
Métonymie de la distance, va et vient entre le corps de l'Afrique
et les visages, entre monde intérieur et extérieur, Yaaba
raconte aussi la mise à l'écart d'un monde et d'un cinéma.
Mais le film aborde aussi ces territoires intimes où l'identité
personnelle est possible. Identité possible soit dans la disparition
du monde (le mot revient souvent dans le film et les enfants
jouent sans cesse à disparaître), soit dans la révélation
des corps (chair ouverte, adultère révélé, passé des ancêtres
révélé, etc.). Mais toujours dans le choix et l'émancipation.
LES REGARDS, TERRITOIRES INTIMES
L'identité et l'harmonie passent dans Yaaba à travers
des instants intimes et personnels, soit par la parole à voix
basse (les enfants chuchotent souvent pour eux-mêmes comme
au théâtre), soit par des lieux confinés (la case où s'enferme
une femme, le bosquet où se cache le couple illégitime et
où se dissimule Bila, etc.). Mais, une autre formule permet
de vivre pleinement son « soi » avec l'Autre, c'est
le regard, le partage des regards pour être plus exact encore.
Le regard, seul, n'est peut-être plus suffisant, il faut « l'échanger »
désormais.
| |
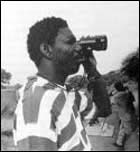 |
|
|
Yaaba fourmille
ainsi de raccords-regards entre les êtres vivants et « voyants »
du film. Jean Rouch parlait d'ailleurs de ce fondement social
et cinématographique au sujet d'Idrissa Ouedraogo précisément
: « Je parle avec lui [Ouedraogo] et je lui dis que dans
le cinéma ce qui manque aujourd'hui, c'était les raccords-regards
et que dans le cinéma muet le regard était essentiel. Et
il me dit « Mais où est-ce qu'on peut apprendre ça ? ».
Je lui dis : « Tu vas à la Cinémathèque Française
voir les anciens films ». Et c'est là, où nous
avons tous travaillé. Il y avait cette découverte extraordinaire
des regards ». (2)