 |
|
|
|
Le point de vue
s’engage dès lors dans une perspective mémorielle, du regard
qui trace les lieux de rupture et de continuation, de ce qui
relève du temps passé. Kamel le héros est celui qui observe,
tel un scanner qui balaye de haut en bas et de droite à gauche
l’espace entre ciel et gazon, et où sont rangés, immuables,
tous ces blocs d’immeubles, si obstinément ordonnés. Souvent
sans parole, musical, ce regard en contre-plongée pourrait
être celui des enfants de la cité, qui toujours ont le ciel
comme ligne d’horizon. Cette ouverture au vent et au soleil
les conduit très à emmener Kamel au secret de la forêt, là
où se niche un lac et les poissons à pêcher. Scène incongrue
qui troue le récit de sa poétique charnelle, digne de Renoir
par toute ce qu’elle suggère de plaisir au temps, dans un
plan qui résume à lui seul toute la politique du corps. D’un
récit qui permet l’échappée belle à toute les contraintes,
et celle en premier lieu de la narration. Kamel devient un
corps du ressenti, à l’image du film qui tente de capter presque
peau à peau ce qui se noue et se tord entre ces gens. L’enjeu
du film repose donc dans cette liberté de mouvement de tout
un chacun, dans un espace de vie plusieurs fois circonscrit
: la pression familiale (la mère refuse la petite amie française
de son fils aîné) sociale (trouver du travail sans papier
relève de la gageure, patron arable ou pas; à la police, (flicage
abusif des jeunes déambulant avec leur propre scooter) aux
dealer, (les jeunes se comportent comme des petits caïds extrêmement
violents).
Venu de l’ailleurs, d’un pays sans visage si ce n’est le sien,
celui d’un enfant d’ici rejeté là-bas, cette Algérie comme
grand fantasme de l’exclusion punitive, Kamel est ce corps
vieilli d’un homme plus si jeune que ça, qui est dans l’entre
deux d’une histoire de l’immigration. Une histoire que la
mère incarne : celle des bidonvilles et du passage de la boue
à la cité.
| |
 |
|
|
La première scène
dialoguée du film nous amène dans une cuisine d’un immeuble.
La mère et la fille au travail de la pâte à pain discutent.
Il faut dire l’humour mais aussi la beauté du regard du cinéaste
qui filme en gros la rondeur de la pâte à pain, cercle doré
qu’une féminine main étale, comme une invitation à sentir
le moelleux. Si la mère porte la trace de l’ailleurs (habit
traditionnel) la fille s’engage dans une autre vie, celle
de l’accession à la propriété ici, en France où elle dit son
écœurement de la cité. Le temps ancien, discrètement évoqué
par la mère, de ce souvenir de bidonville (sûrement celui
de Nanterre) sera la seule allusion au passé des parents.
Tout comme cette discussion entre le mari et la femme où il
lui dit l’échec du retour au pays et combien ce mythe lui
a valu un surendettement.
Au sein de cette cité de Montfermeil, en Seine Saint-Denis,
quatre grandes figures du mode d’habitat s’élaborent dans
le film, que l’on pourrait caractériser par un mot : clivage.
Il y a celui des parents, cette immigration ouvrière et familiale,
qui, de la paysannerie algérienne en grande partie, sont devenus
en France les premiers habitants des constructions issues
des Trente Glorieuses, d’une France où la salle de bain et
l’électricité devenaient accessibles pour tous. Il y a ensuite
leurs enfants, les aînés qui sont partagés entre le chômage,
pour certains des hommes (Kamel tourne en rond à chercher
en vain du travail) et la rupture pour les filles (réussite
à l’école, accès à la petite bourgeoisie) et celle-ci se situe
dans le hors-champ du film, comme si ce monde était définitivement
étranger à la cité. Il y a les plus jeunes qui refusent l’option
du frère (se lever à six heures du matin pour se voir refuser
un travail) et l’option de la sœur (vivre ailleurs avec un
« Français » même pas marié), c’est le cas du plus jeune frère
qui deale et s’organise une vie avec cette économie parallèle.
 |
|
|
|
Si le surplace
est aussi son domaine partagé avec son frère aîné, il est
plus restreint, allant du lit à la cage d’escalier, du hall
à la cave et le terrain vague comme unique échappée. Et ce,
avec l’omniprésence, à la fois discrète mais visible, des
policiers, à pied ou en voiture, qui semblent déjà ceinturer
cet espace. Le terrain vague rassemble en lui toute une poétique
de l’espace où chacun des jeunes qui l’occupent semble devenir
aussi beau et aussi grand que le ciel. Première accroche du
film, où nous voyons des jeunes hommes jouer au foot, sous
l’œil attentif de leur chien, la caméra au raz du gazon les
filme comme des demi-dieux sublimes de jeunesse et de vivacité.
Le terrain vague devient l’espace privilégié pour déployer
toute une scénographie de plaisir et de joie, et où il devient
possible de jouer au golf. Scène tendrement burlesque et incongrue,
et par cette scène, le cinéaste nous invite très finement
à reconsidérer notre système de représentation d’une certaine
jeunesse des banlieues, à la manière de Kechiche qui avec
son splendide film L’esquive, traçait une ligne d’amour
au cœur d’une cité morose.
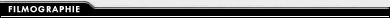 |
|
2001
Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ?
avec Ameur-Zaimeche
|
|
|