Le spectateur
Émancipation
| |
 |
|
|
Émancipation
d’un enfant. Il sort des « jupes » de son père,
mais aussi il s’approprie un discours Le père : il ne
peut rien pour les gens, pas d’apitoiements, l’aide qu’il
peut donner est mince. La voiture, comme espace protégé.
Le trajet : de la périphérie au cœur de l’humanité. La
voiture tourne autour de Koker, s’en approche, puis s’en éloigne,
prend des raccourcis qui s’avèrent être des culs-de-sac, fait
des détours, s’enfonce dans l’inconnu. (cf. la magnifique
séquence de fin :
Derrière le dispositif, derrière la forme, une vérité humaine,
une vérité du monde. « Raconte-moi ton histoire »
Au cours du trajet, le réalisateur
s’arrête de nombreuses fois, embarque des passagers, les questionne.
Il y a sa nature, sa fonction de conteur qui revient (il n’a
pas complêtement baissé les armes) lorsqu’il demande que chacun
lui raconte comment ça s’est passé. Il se fait alors, tout
comme le film, réceptacle de témoignages uniques, d’histoires
individuelles, de récits personnels. Au-delà du drame à l’échelle
nationale qui s’est joué (dont la communication ignore l’individu
au profit de la masse), chaque récit prend la forme d’une
petite fable (celui qui raconte que ce sont les moustiques
qui l’ont sauvés, ceux qui racontent que c’est le match de
foot…). et, malgré la mort, rend à chaque personnage, perdu
dans une comptabilité anonyme de morts, de sans-logis, de
relogés, son statut d’individu unique (qui a eu ou non de
la chance).
Remet en cause la croyance en une volonté divine, le discours
de Mr. Rushi: le cinéma finalement dit la vérité.
Et la vie continue
 |
|
|
|
Pour les individus :
femmes et enfants (cf. en comparaison la fin des Raisins
de la Colère) Deux manières de filmer les personnages :
à travers le cadre de la fenêtre de la portière de la voiture
et en dehors de ce cadre…
Pour l’humanité. S’il y a une dimension divine, elle n’est
pas dans le « fatum », la fatalité, mais plutôt
là, dans ce que la nature et l’humanité a traversé depuis
des siècles, a laissé comme traces immuables : le réalisateur
entre parfois dans la contemplation d’un élément de nature
(à travers le chambranle d’une fenêtre de maison en ruine),
d’une action collective et commune (des femmes qui lavent
du linge, des hommes qui prient à flanc de colline). Un effet
musical vient souligner la contemplation méditative du personnage.
Tous ces instantanés du monde en racontent l'éternité, la
pérénité à travers les siècles. Il y a un au-delà de l’individu :
une communauté dans un monde. Là est le divin. Spiritualité,
mysticisme de Kiarostami.
Ce trajet,
cette quête, voire cette évolution entre un père et son fils
n’est qu’un prétexte pour redonner à des hommes (en l’occurrence
surtout des femmes et des enfants) une individualité spécifique.
Et (4) la replacer dans une histoire de l’humanité.
Le plus important n’est pas de retrouver les enfants vivants
ou non. Il serait particulièrement malvenu de jouer le mélo,
tandis que d’autres destins aussi importants ont été croisés
par l’homme et son fils.

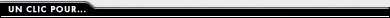 |
|
|
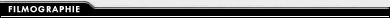 |
|
1970 Le Pain et la Rue,
premier court métrage
1972 La Récréation
(cm)
1973 Expérience
1974 Mossafer
/ Le Passager
1975 Deux solutions
pour un problème, Moi aussi je peux (cm)
1976 Le Costume
de mariage (cm), Les Couleurs (cm)
1977 Gozarech
/ Le Rapport
1978 Solution
(cm)
1979 Cas numéro
1-Cas numéro 2 (cm)
1980 La Rage de
dents (cm)
1981 Avec ou sans
ordre (cm)
1982 Le Chœur
(cm)
1983 Le Concitoyen
(cm)
1984 Avali ha
/ Les Elèves du cours préparatoire
1985 Les Premiers
1987 Khaneh-ye
doust kojast? / Où est la maison de mon ami?
1990 Mashgh e
shab / Devoirs du soir
1990 Nema-ye Nazdik
/ Close-up
1992 Zendegi Edamé
Dârad / Et la vie continue
1994 Zir e Darakhtan
e zeytoun / Au travers des oliviers
1995 Repérages
et Lumière et compagnie (cm)
1996 Tam'e Guilass
/ Le Goût de la cerise
1999 Bad Mara
Khahad Bord / Le Vent nous emportera
2000 Sleepers
2001 ABC Africa
2002 Ten
2004 Ten on Ten
et Five
|
|
|