| |
 |
|
|
Dès le début,
la mise en scène nous informe sur l’aspect fictionnel du film
que nous voyons. Première séquence : nous sommes dans
une caisse de péage devant laquelle défile des voitures. Apparaissent
dans le cadre, les conducteurs des véhicules qui payent leur
ticket d’entrée pour accéder à la route principale. Visuellement,
cette file de conducteurs nous rappelle une autre file, celle
qui se tient devant la caisse d’un cinéma. Comme chaque conducteur,
chaque spectateur prend son ticket pour accéder à un espace,
synonyme de voyage immobile: la salle de cinéma.
Comme chez Hitchcock avec tout le début de Psychose par
exemple, la voiture joue un rôle de vecteur, de bulle protectrice
comme le spectateur de ciné dans une salle de cinéma)…
- A un moment le garçon fait avec ses doigts le geste que
fait tout réalisateur pour choisir son cadre. Un plan nous
montre ce qu’il voit à travers ses doigts. Il s’agit de nous
dire que tout plan est pensé, imaginé avant d’être filmé.
- le garçon s’endort à l’entrée du tunnel… le générique du
film. N’apparaît que lorsque le garçon s’endort dans le tunnel…
Ça y est le film commence. Au sortir du tunnel, nous sommes
ailleurs… Il s’agit d’une représentation du dispositif qui
se joue entre le spectateur et le film. En sortant du tunnel,
c’est-à-dire à la fin du générique, nous sommes ailleurs :
des dizaine d’hommes et de femmes, sur le bord de la route,
s’affairent à la reconstruction de ce que le tremblement de
terre à détruit. Il y a bien un avant et un après le tunnel,
comme il y a bien un avant et un après le noir qui se fait
dans une salle de cinéma, un avant et un après le générique.
D’une certaine manière ce qui se joue pour les personnages
du film (le réalisateur et son fils) est la même chose qui
se joue pour le spectateur.
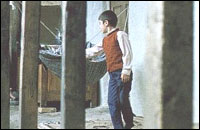 |
|
|
|
A deux moments,
ce film-ci dévoile et dénonce son propre dispositif, et sa
remise en question en tant que dispositif documentaire. Tout
d’abord, la séquence avec le vieux. Kiarostami place le spectateur
dans le point de vue de l’enfant, et de manière très pédagogique,
non sans humour , rappelle que le film qui se déroule est
immanquablement mis en scène.
Et ensuite, alors que le fils du réalisateur réclame de l’eau,
le vieil homme s’adresse à la caméra, à l’équipe de tournage,
en leur demandant où se trouve le bol qui aurait dû être là.
Une voix hors-champ qu’on analyse comme étant celle de Kiarostami
demande à la scripte de s’en occuper. La scripte apparaît
en courant dans le cadre, lui apporte le bol et disparaît.
Pourquoi pas un documentaire finalement : permet de raconter
des histoires (celle du père et du fils essentiellement)
|