CHANT D’OISEAUX DANS UN PAYSAGE DE BATAILLE
Depuis qu’il a éclaté il y a
une trentaine d’années, le conflit en Irlande du Nord a largement
contribué à ce triste répertoire d’images télévisées sur la
violence, l’échec politique et la perte de vies humaines. Et
la fiction du grand et du petit écran en a fait tout naturellement
un de ses thèmes. Deux des films produits pour la télévision
anglaise sont au centre de cet article, à savoir Contact
et Elephant, réalisés par Alan Clarke (1935 – 1990).
Héritier de la tradition du free cinema des années cinquante
et soixante, Clarke fait partie de ces cinéastes britanniques
préoccupés par les questions émergeantes de leur contexte social
immédiat. La délinquance juvénile, la peine de mort, le chômage,
l’inceste, le racisme et la corruption font partie des sujets
que le metteur en scène a abordés dans des films tels To
Encourage the Others (1972), Penda’s Fen (1974),
Diane (1975), Scum (1977 et 1979), Beloved
Enemy (1980) ou Road (1987). Leurs protagonistes
sont très souvent des exclus de la société industrielle contemporaine
- des sans-abri, des chômeurs, des jeunes défavorisés comme
le skinhead Trevor dans Made in Britain (1983) ou des
hooligans dans The Firm (1988). Dans la trentaine de
films qu’il a tournés depuis le début des années soixante-dix,
le réalisateur pose un regard critique et sans complaisance
sur son environnement culturel, un regard qui révèle les zones
d’ombres au sein de la société britannique dans des films qui
accordent la parole à ses laissés-pour-compte et qui vont à
l’encontre de l’idéologie politique dominante.
DE LA VIOLENCE ET DES HOMMES
| |
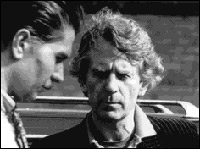 |
|
|
Clarke a réalisé la plupart de ses films
pour la télévision. Il en est ainsi pour Contact et Elephant
qui ont été produits pour la BBC de l’Irlande du Nord ; le premier
en 1984, le deuxième en 1988. « Contact and Elephant
function as a cinematic diptych about the Irish problem ».
(1) : Contact traite du quotidien d’une section de soldats
britanniques à Crossmaglen dans la province du South Armagh
; Elephant, tourné à Belfast, décrit une série de meurtres
politiques. Le récit filmique de Contact (2) est constitué
des épisodes du quotidien des jeunes soldats qui sont répétés
trois fois : l’action, c’est à dire la patrouille, le repos
après celle-ci, la préparation de l’action suivante. Dès les
premières images, la violence est introduite comme figure centrale.
Les soldats arrêtent une voiture sur une route en pleine campagne
; ils la fouillent, menacent les occupants et tuent l’un d’eux.
En fait, l’action militaire se définit par la recherche de terroristes
et de bombes. À un moment donné, le commandant examine une voiture
garée au bord de la route. La caméra s’attarde sur la voiture
et l’homme, créant ainsi un sentiment de grande tension. La
recherche n’aboutit pas ; il semble que la voiture ne soit pas
piégée. Ce n’est qu’au moment où le commandant s’éloigne du
véhicule suspect que la tension diminue. Pourtant, elle n’est
pas complètement évacuée. Le doute intervient quand, sur un
signe de l’officier, un des jeunes soldats s’approche de l’automobile.
Ce sentiment de doute est tout de suite confirmé. On voit le
commandant qui disparaît dans le paysage et on entend l’explosion
dont le soldat est victime. Craignant d’être tués à chaque moment
par un franc-tireur ou des explosifs cachés, les soldats vivent
une menace réelle en se trouvant face à un ennemi qui, la plupart
du temps, reste invisible.
|