 |
|
|
|
L’adolescent qui peuple ces films
est ce qu’il est convenu d’appeler un nerd. Le nerd
a plusieurs caractéristiques : il communique mal et
peu avec son entourage, s’avère plus intelligent que la moyenne
et consacre l’essentiel de son temps à sa passion (qui peut
être d’ordre scientifique ou artistique). On retrouve ce profil
aussi bien dans des films déjà primés (Alex dans Elephant),
que dans les films américains moins connus comme The United
States of Leland (Leland ne parle avec personne) ou encore
Mean Creek (George est détesté de tous). Ces anti-héros
se distinguent par une éducation et une sensibilité indéniables,
mais également - et cela est nouveau - par un comportement
violent. Leur profil est donc ambigu, tant il est vrai qu’ils
sont capables du meilleur comme du pire. Tantôt ils assassinent,
tantôt ils écrivent, filment ou jouent de la musique classique.
Ils ne sont pas mauvais nous dit-on. Pourtant ils tuent. Et
si entre les deux - le meilleur et le pire - il existait un
lien ? Il semble bien que ces films, avant même de représenter
des meurtres, décrivent presque toujours un échec de l’expression
par la création : échec d’Alex de jouer une bagatelle
de Beethoven, échec de Leland de transmettre ce qu’il a écrit,
échec de George d’être au monde comme il l’est dans ses films.
Dès lors qu’il y a impossibilité de créer, de s’exprimer
et de transmettre, tout bascule dans une sorte d’absurdité
généralisée, tout devient gratuit. L’autre ne comptant plus,
il disparaît en même temps que la tentative de partager avec
lui.
| |
 |
|
|
De tels adolescents hantent la plupart
des films indépendants américains. Ils se filment (d’American
Beauty de Sam Mendes à Nowhere de Greg Araki),
s’étripent (de Bully de Larry Clarke à Mean Creek
de Jacob Aaron Estes), se droguent et se suicident ( de Doom
generation toujours de Greg Araki à Gummo d’Harmony
Korine). « The Sick Fucking Kid »
(SFK est dans The United States of Leland une catégorie
officieuse qu’utilisent des professeurs de prisons) n’est
pas irrémédiablement condamné. Larry Clark par exemple, semble
dans son dernier film (Ken Park) trouver une solution
à ses problèmes : le sexe, mais du sexe qui réapprend à vivre
ensemble, sain et communautaire. Mais bien peu avancent comme
lui des solutions individuelles ou globales aux maux dont
souffrent les adolescents et à travers eux la société américaine
entière. Le propos de ces films n’est en réalité pas d’avancer
des hypothèses censées rendre compte ou remédier à une réalité
problématique, mais de scruter dans un espace donné – le plus
souvent clos (ici des couloirs de lycée, là une chambre d’étudiant)
– des corps qui, pris au piège, s’agitent. Ils ne parlent
pas ou peu (il faut rappeler à cet égard combien le silence
d’Elephant est éloquent), et ce mutisme attise leur
agitation. Ce qui ne peut passer par la parole se manifeste
autrement, presque par effraction, à travers eux. Ils s’apparentent
dorénavant moins à des personnages qu’à des outils. Rudolf
Arnheim rappelait à cet égard que lorsqu’un acteur devient
un accessoire, il n’est pas rare que les accessoires jouent
le rôle d’acteur (1). Ainsi faut-il souligner la place qu’ont
les décors dans ces films : la profondeur des couloirs
dans Elephant, l’oppressante verticalité des rues dans
Kids, le remous périlleux d’un fleuve dans Mean
Creek. Deux logiques coexistent dans ces films :
le vide qui isole les personnages et les rend impuissants
(ces films sont anti-macmahoniens par excellence) ; les
décors qui cernent le vide et participent de la mise en scène
générale. Deleuze parlait à propos d’Antonioni et de son ambition
de critiquer la morale, d’une méthode de « symptomatologiste ».
C’est bien de cela qu’il s’agit ici, et nombre de ces films
ne sont pas indifférents à l’esthétique d’Antonioni. En choisissant
de placer des personnages déviants dans des dispositifs contraignants,
ils cherchent à produire des réactions, des incidents plus
ou moins irréversibles, qui ne portent pas directement à conséquence,
mais renseignent – un peu à la manière de ces bourgeois névrosés
qui peuplent l’univers antonionien – sur les failles d’un
système déréglé, de plus en plus menacé par l’anomie. Car
ces faits divers reposent tout entiers sur l’impossibilité
non pas de transmettre une morale aux petits criminels, mais
de faire apparaître ne serait-ce que les oripeaux de ladite
morale. Ces films, en définitive, accusent davantage qu’ils
ne jugent des corps privés à la fois de principes et de parole.
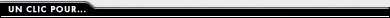 |
|
|
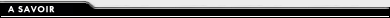 |
|
(1)
Cité par W.Benjamin, Œuvres T.III. p.292
|
|