.....................................................
OUTER SPACE
De Peter Tscherkassky, 1999, 10’
Perfection d’escamotage visuel et de dysnarration
chaotique, Outer Space défie la capture filmique
classique. Délinéarise une scène initiale
de The Entity / L’Emprise (1981), de Sidney
J. Furie (une femme menacée par l’irruption, dans
sa maison, d’une présence (suggérée)
étrangère et non visible), en la déformant
et la consumant photogramme par photogramme, jusqu’à
son implosion pelliculaire. Réécriture guerrière où
s’enchevêtrent les possibles et où le spectateur
construit son propre chemin, chemin de traverse d’un cauchemar
introspectif, chemin de fuite, inutile, avant l’hypnose
rétinienne.
Attaque chimique de l’image, attaque d’une
force dévastatrice en hors-champ. Dans la dégradation
de l’image (la saute, continue, transmuée en figure,
est érigée en système de dé-montage)
et dans l’éructation sonore sourde ou aiguë,
se joue la montée de l’angoisse. A l’usage du flicker
qui met en danger le régime survolté de l’image,
dont l’unité, la saute, est à peine échaudée
et bientôt destructrice, succède l’effet kaléidoscopique
du visage, qui s’abîme dans un cri.
Outer Space ou la fabrique
de l’irreprésentable. Le tremblement de terre
et de pellicule devient alors flicker continu de
lumières surexposées, éclairs imprimant
et lacérant la rétine de couperets blancs
et noirs. Douce explosion capitonnée par les jets
de lampe brisée, les cris de guerre étouffés
et les assauts assassins d’un montage apocalyptique :
Norman Bates, surgi de Psycho, s’est emparé
du couteau servant d’instrument de travail du cinéaste
et cisaille la peau de l’image qui va rompre. A pleine vitesse,
la combustion de la pellicule incandescente gagne le défilement
hystérique de l’image, au devenir-lumière.
Le blanc s’en empare peu à peu, mais n’y parvient
pas. Les collures se battent contre l’emprise du champ du
blanc, en repoussant le brasier des photogrammes, prêts
à consumer ce qu’il reste comme matière. Les
faisceaux l’emportent finalement, ayant happé l’œil
mort du spectateur et dévasté sa perception
rétinienne.
Violence et psychose à l’image,
violence et dépeçage de la pellicule. La femme
projette son visage contre une glace, elle entreprend la
destruction de son propre reflet. Le travail de Peter Tscherkassky
mime cet auto-défigurage de l’image. Dépossession
du personnage et de l’image : le miroir brisé
incarne autant la folie intérieure de la femme que
la déformation propre au found footage. Et
après le chaos (stéréo)scopique ?
Molestée et calcinée, l’image renaît
de ses cendres spectrales. La figure originelle s’est dissolue,
dilatée entre les interstices d’un défilement
névrotique meurtrier. L’image aliène donc.
Outer Space percute la narration filmique et touche
à l’abstraction, en joignant au gré des massacres
sublimes et des collures infernales, l’emprise initiale
au traitement pathologique de l’image.
.....................................................
THE DOG STAR MAN HAS A TOO BIG FLAMING
COCK FOR THE SHEBA QUEEN
De Frédéric Charpentier, 1991, 24’
THE COLOR OF LOVE
De Peggy Ahwesh, 1994, 10’
 |
|
|
|
Entre découverte, sifflements,
battements de mains ironiques et autres réactions
variées du public, voilà deux films déroutants
qui réemploient brillamment des séquences
pornographiques préexistantes et provoquent un questionnement
sur leurs modes de représentation. Frédéric
Charpentier et Peggy Ahwesh travaillent autant sur la frustration
de la vision, dans l’attaque du défilement des photogrammes,
que sur les actes sexuels mêmes, dans la répétition
de boucles d’images aussi naturelles que subversives. Pour
The Dog Star (…), après dix minutes de patchworks
de poussières, naît péniblement la première
image pornographique, pure, presque salvatrice : la fellation
d’une verge, dépourvue de toute mécanique,
semblant conditionnée par l’irreprésentable,
le désir, la sensation, la recherche effrénée
d’une jouissance qui viendra calmement, plus tard, dans
un intervalle repoussé au loin en hors-champ, et
dont ne sera visible que la métonymie, le séminal,
la lente éjaculation. Dans les deux films, ce qui
se délivre à l’image avec peine se mérite :
soudain dans The Dog Star (…), du brouillage de l’image
émerge une simple fellation, saturée formellement
de grattages et laissant passer brièvement les effluves
d’un désir lancinant, palpable, qui anoblit doucement
les séquences initiales.
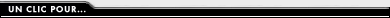 |
|