Cette même esthétique
est utilisée par Emmanuelle Bercot (La Puce) pour
son premier long-métrage, tiré de la collection Petites
Caméras d'Arte : Clément. Sur un sujet sulfureux
(une trentenaire tombe amoureuse d'un garçon de treize ans
et décide d'assumer sa passion), Bercot réussit un objet
glaçant, d'un pointillisme psychologique si vériste et subtil
qu'on aurait aimé voir le même film sans avoir cette nausée
permanente due à l'image numérique sans cesse mue. Le récit
démarre presque anodinement, bifurque vers la passion et
retombe au final presque banalement et si cruellement lorsque
l'adulte se rend compte de l'artificialité de l'amour qu'elle
reçoit. Jouant le rôle principal, Bercot donne une épaisseur
hystérique à cette amoureuse transie rongée par l'impossibilité
de ses sentiments. Si la comédienne en fait parfois trop,
la cinéaste parvient à passer outre le rudimentaire de son
image pour toucher à de belles idées de mise en scène, autour
des corps et de la mer, des intérieurs et des espaces. Un
beau film qui aurait mérité un traitement plus ambitieux,
bien que l'esthétique documentaire lui confère une portée
autre.
| |
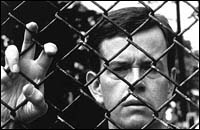 |
|
|
Insignifiant se révèle en
revanche le premier film des comédiens Jennifer Jason Leigh
et Alan Cumming, The Anniversary Party. Chronique d'une
soirée entre amis bourgeois brillants dans leurs domaines
artistiques respectifs, du droit à l'écriture en passant par
le cinéma, le scripte se transforme en une pièce de théâtre
sans narration, kermesse des langues amères si peu surprenante.
Après les gaffes vexantes, les jeux très drôles et l'ecstasy,
on touche au ridicule lorsque les personnages miment le délire
psychotrope. L'aube nous sauve et clôt un espace de liberté
pour des acteurs en roue libre, qui s'amusent sans leur public.
A sauver : Gwyneth Paltrow en pétasse blondasse finalement
pas si conne...
Todd Solondz (Bienvenue dans l'âge ingrat, Happiness)
proposait un film qui garde la veine corrosive et cruelle
de ses précédentes productions. Storytelling est une
farce cynique qui prend pour cible les tabous et plus encore
la peur hypocrite de les aborder. Handicapés, racisme, perversions
sexuelles, médiatisation carnassière nourrissent la verve
du cinéaste dans une fiction scindée en deux parties autonomes
qui entretiennent de lointains échos. Pour chacune d'elles,
il s'agit de fustiger l'éducation, d'abord en fac puis au
lycée. Ce regard biaisé sur des perdants qui s'ignorent prend
une tournure plus torve lorsque Solondz met en abyme la forme
documentaire. Un médiocre cinéaste suit la vie inactive et
sans ambition d'un adolescent loqueteux pour mieux décrépir
la société dans laquelle il évolue, et c'est une pure tranche
de vie empoisonnée. Succulente, donc.
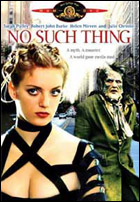 |
|
|
|
Hal Hartley se rend au même
pays de la subversion mais emprunte des routes moins agressives.
No Such Thing revisite le mythe de la belle et la
bête pour le manipuler à l'extrême. Une héroïne adorable
entreprend un voyage en Islande pour retrouver son petit
ami, parti étudier un célèbre monstre. Elle rencontre un
être désabusé qui ne demande qu'à quitter le monde des vivants
et que l'invincibilité irrite au point de devoir tuer de
colère tous ceux qui ne parviennent pas à l'exécuter. Seul
son créateur peut le délivrer. Et la jeune fille de ramener
la curiosité acariâtre aux Etats-Unis pour retrouver le
professeur responsable... La transposition du mythe n'est
pour Hartley qu'un prétexte à écorcher la société de communication
et de médiatisation actuelle. Opposant Nature et Culture,
Homme et Monstre, Etats-Unis et Islande, le film est sans
cesse basé sur une dualité cynique. L'humour décalé et le
ton distancié du récit permettent une acceptation très immédiate
de l'argument merveilleux. La spirale scénaristique ménage
une large plage à l'émotion dans un film réellement réussi,
jusqu'à sa photographie empreinte d'une sourde poésie.