A Annecy, la Biennale du cinéma espagnol existe depuis
20 ans. Au départ conçu comme un événement
unique, son succès en fit un rendez-vous régulier.
Cette année la programmation fut riche et permit de voir
des aspects divers d'une production cinématographique
espagnole qui passe difficilement les Pyrénées,
hormis quelques exemples récents (Pau et son frère).
Huit films furent présentés en compétition,
des premiers ou seconds films, et plus d'une trentaine de films
en panorama. Il est clair que sur cet ensemble qui représentait
près de deux années de production du cinéma
d'un seul pays, il y eut du bon et du mauvais. Mais quand sur
une production internationale, on ne voit souvent qu'une poignée
de très bons films, il est toujours rassurant pour la
créativité d'un pays que quelques-uns de ses films
sortent du lot.
|
| |
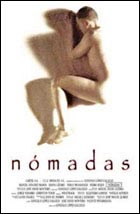 |
|
|
Dans l'ensemble, cette année
fut plutôt réussie, révélant un
cinéma bien vivant, se renouvelant plus franchement
que le cinéma italien dont le précédent
festival à Annecy montra surtout les difficultés
créatives. Si les films n'ont jamais réellement
surpris par leur démarche formelle (hormis Nomadas,
le grand prix; on y revient) ils peuvent s'enrichir de sujets
nouveaux, originaux, de scénarios ambitieux, volontairement
ancrés dans la réalité sociale d'un pays
qui ne cesse de dialoguer avec ses démons du passé,
la guerre civile et la dictature.
Ainsi, beaucoup de films prennent la guerre pour sujet, que
ce soit de manière frontale ou détournée:
Silencio roto de Montxo Armendariz décrit la
vie d'un village à la fin de la seconde guerre mondiale,
au moment où la dictature s'installe et élimine
progressivement les derniers républicains se terrant
dans le maquis. Le réalisateur s'intéresse ici
surtout aux relations des villageois et à la difficulté
de choisir son camp, aux trahisons et à la nécessité
de croire dans les idées démocratiques. Le film
est sobre, sa mise en scène extrêmement dépouillée.
Pourtant en dépit d'un sujet fort, d'une direction
d'acteurs efficace et rigoureuse, d'une photo superbe, le
film ne se démarque jamais de son académisme
et présente peu d'idées de réalisation,
ce qui plombe le récit et émousse pour une grande
part l'intérêt. L'échine du diable,
du talentueux Guillermo del Toro, installe son récit
fantastique, mélodramatique et baroque sur un arrière
plan de guerre civile où les actes les plus barbares
ne trouvent plus de punitions. Dans un orphelinat en pleine
zone désertique de l'Espagne, un jeune garçon
dialogue avec le fantôme d'un orphelin assassiné.
Le scénario fait se croiser la guerre civile, la cruauté
du surveillant de l'orphelinat (Eduardo Noriega, présent
dans toutes les grandes productions espagnoles) et les peurs
enfantines face à la mort et à la guerre, symbolisées
ici par la présence d'un spectre réclamant justice.
Del Toro, auteur du très mauvais et hollywoodien Mimic
(sinistre navet à base d'insectes géants
dans les profondeurs de New York) revient ici avec un film
plus personnel, au scénario plus lyrique. Comme Amenabar,
aujourd'hui adulé de tous grâce à Los
Otros avec Nicole Kidman (pâle clonage de Sixième
Sens et du film que Jack Clayton réalisa
à partir du Tour d'écrou de Henry James),
Del Toro lorgne délibérément du côté
américain avec sa mise en scène soignée,
très classique sans être pesante, car toujours
animée d'un souffle poétique inspiré
autant par le fantastique gothique que par les thèmes
visuels du western. Malgré son spectaculaire affiché,
le film peut plaire par sa grande maîtrise et son regard
attachant qu'il porte sur l'enfance.
|