|
FILMS DENFANCE
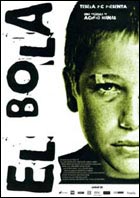 |
|
|
|
L'enfance justement est
au cur de beaucoup de films récents en Espagne. Souvent
une enfance perdue, bafouée, humiliée. Comme
si l'Espagne, ce grand pays vieillissant, craignait pour sa
jeunesse, s'inquiétait pour ses rêves de liberté.
Deux films particulièrement réussis, présentés
en compétition, expriment ce sentiment de perdition
de l'enfance et de l'adolescence. El Bola de Achero
Manas, film ambitieux par son sujet plus que par son traitement,
raconte l'amitié entre deux jeunes garçons,
dont l'un se fait battre par son père. Film sur la
maltraitance, mais surtout film sur l'amitié, El
Bola évite les pires clichés propre à
ce type de sujet. Essentiellement parce que la caméra
n'est jamais intrusive, et ce même lors de la scène
où le père de Pablo (joué par un excellent
Alberto Jimenez en tyran familial) s'acharne sur son fils
(le petit Juan José Ballesta non moins excellent).
Pas de complaisance dans cette violence insupportable, tenue
à distance par un filmage réaliste, exempt de
pathos ou de point de vue sur-déterminé. El
otro Barrio (l'autre monde) de Salvador Garcia Ruiz, autre
film sur l'adolescence, est lui aussi plein de violence :
violences symboliques de la société sur les
jeunes, de la cellule familiale, violence des sentiments et
de la misère sociale. Ramon Fortuna, 15 ans, est accusé
de meurtre à la suite d'accidents malheureux dont il
est l'involontaire auteur. Son avocat vient du même
quartier que lui, un quartier populaire qu'il a quitté
pour oublier une enfance qu'il a détestée. Les
deux personnages vont se retrouver autour de l'absence du
père, des douleurs de l'enfance, de la non-reconnaissance
au sein de la famille. Le film laisse un sentiment poignant
de vague nostalgie. D'une grande maîtrise, d'une élégance
rare de mise en scène, il fait vivre ses personnages
avec tendresse et leur donne une grande force allégorique
: Marcelo, l'avocat, vit sans vivre, à côté
d'un passé qu'il a voulu nier et qui resurgit avec
ce jeune garçon perdu, plutôt victime que coupable,
représentant toute la vacuité d'une adolescence
qui à l'orée de son envol dans l'avenir d'une
vie d'adulte, ne voit que le vide et la rudesse d'une société
mortifère. Malgré ses baisses de tensions dramatiques,
le film développe un récit crédible,
tenu par un filmage souvent inspiré. Une des bonnes
surprises du festival.
Si ces films présentent des atouts réels tant
du point de vue de leurs récits que de leur réalisation,
ils restent assez conventionnels du point de vue du langage
cinématographique. Peu de jeunes réalisateurs
se risquent à une démarche rompant avec les
habitudes narratives et le terrain de l'expérimentation
est peu occupé. Deux films s'y risquent, bien qu'ils
restent tout à fait lisibles, voire classiques par
certains aspects. Le premier, Pau et son frère
de Marc Recha qui fut en sélection officielle au précédent
festival de Cannes, est singulier dans sa démarche
poético-naturaliste. Le récit de deuil, très
pudique, fait se retrouver les personnages autour de l'absence
d'un frère, fils ou amant, et se réconcilier
à la vie et à la force sauvage de la nature.
La caméra reste à l'épaule, décrivant
des rondes dansantes autour des corps des comédiens,
souvent proche des visages. Les paysages de la Catalogne,
oscillant entre inquiétude et douceur, sont captés
avec intensité et délivrent leur mystère
sombre. Par son esthétique très pure, sa force
païenne et tellurique, son cheminement narratif dolent,
comme un rêve brumeux dans l'il du spectateur, ce film
constitue une des plus indépendantes démarches
cinématographiques de ces derniers temps (faisant irrémédiablement
penser à celle de Claire Denis en France).
| |
 |
|
|
Le second film, Nomadas
de Gonzalo Lopez-Gallego, qui reçut à la
fois le Prix du Jury Jeune et le Prix du Jury, engage une
esthétique tout aussi singulière. Le Jury voulut
sans doute en lui décernant son prix, récompenser
une démarche formelle audacieuse dans une sélection
de compétition qui en manquait certes cruellement.
De plus, pour une première uvre, le film présente
des qualités de filmage indéniables. Il s'agit
d'une lente dérive de quatre personnages autistiques
dans un monde glacé. L'image est belle ; dès
le début elle nous saisit par son grain post-moderne
à la Cronenberg (le garage d'Alex, le mécano
autiste qui assassine ceux qu'il doit dépanner, ressemble
étrangement au garage de Willem Defoe dans ExistenZ).
Garage vide, intérieurs vides (mais stylisés),
visages hagards derrière des pare-brise mouchetés
de pluie où se reflètent de phares, etc. Lopez-Gallago
sait créer un climat, utiliser toutes les ressources
du cinéma, son, lumières, montage, sait installer
une durée, a deux ou trois bonnes idées. Malheureusement
ça ne suffit pas de savoir filmer, encore faut-il savoir
quoi filmer. Au bout de quinze (très bonnes) minutes
on comprend vite dans quoi le film sombre : une insupportable
suite de clichés, de scènes grotesques où
tout nous est surligné, comme si le plan ne se suffisait
pas à lui-même ; non, il faut en rajouter, et
vas-y que j'envoie la musique à fond quand l'autiste
dépanneur dézingue un type à coup de
clé de 20, et vas-y que je fais s'acharner un autre
autiste sur le dépanneur pendant trois plombes (mais
attention, j'utilise le hors champs, histoire de montrer que
je connais mes classiques) ; l'autiste dépanneur
a une passion pour le lait telle, qu'une bouteille vide le
met dans des transes folles (le jeune Manuel Sanchez Ramos
n'a malheureusement pas eu la sobriété comme
indication de jeu) ; aussi lorsqu'il se fait tabasser, il
se voit nageant en position ftale dans une mare de lait.
Sara, son alter ego féminin, aussi autiste que lui,
se verra violer à l'arrière d'une voiture. Mais
là, sa chaste main viendra dans un geste définitif
boucher l'objectif de la caméra (sic). Après
le tabassage en règle qu'on a du supporter juste avant,
c'est un peu fort. La coupe est pleine lorsque le pauvre Alex
rescapé, gesticule dans sa salle de bains en hurlant
sur du Beethoven (qu'est-il arrivé au réalisateur
? Vient-il de voir Orange Mécanique ?) Devant
de tels plans, les bras nous en tombent. Ce jeune réalisateur,
sans doute élevé au lait de Lynch et Cronenberg,
nous fait surtout penser au pire Carax. Qu'il se recentre,
et ça ira mieux.
|