L’édition 2002
du festival international du film d’animation d’Annecy, réunion
mondiale annuelle du cinéma d’animation, s’est achevée
samedi 8 juin.
Le festival est chaque
année le lieu d’une prise de pouls d’un cinéma
vraiment différent de celui en " prise de
vues réelles ", comme aiment l’appeler les
animateurs, cinéma qui fait varier les techniques,
les écritures, et propose des conceptions de l’image
quelques fois étonnantes et/ou renouvelantes. Le millésime
2002 est bon, même si au palmarès il y eut quelques
oublis de taille, voire des bizarreries.
|
| |
 |
|
|
Dans l’ensemble on remarqua
cette année un retour en force dans la compétition
des courts, du film expérimental et abstrait. Le grand
prix du festival fut attribué - et c’est un signe -
à Barcode, film du hollandais Adriaan Lokman,
composition en 3D ayant pour matière une figure unique
répétée (un tube gris) qui distribuée
en variations de formes, produit un jeu sophistiqué
d’ombres et de lumières. Malgré ses qualités
techniques indéniables, son aspect rigoriste, ses mouvements
léchés de caméra virtuelle, le film ne
cesse jamais de nous apparaître comme un vain clip vidéo
technoïde n’ayant que sa maîtrise stérile
à défendre. Par son univers de symétries,
son allégeance au numérique glacé, sa
jouissance puérile des boucles, de la répétition
minérale, ce grand prix est énervant. Que le
jury ait choisi de récompenser une façon de
faire du cinéma propre à l’animation, issue
de la tradition des " abstract films "
proche de l’époque des Norman MacLaren et Lejf Marcusen,
c’est tout à son honneur : cela permet de rompre avec
la manie des historiettes vaguement édifiantes, vaguement
poilantes, qui font encore le tout venant des courts métrages
(qu’ils soient animés ou en prises réelles).
Il y avait pourtant dans la compétition des films d’une
autre tenue ; ainsi le passionnant Higgs, de l’allemande
Monika Stellmach, pur travail graphique sur la pellicule,
plongée fantasmée dans le monde subatomique
où règne dans l’invisible, l’énergique
boson de Higgs. Le grattage sur pellicule fit les grandes
heures abstraites de l’animation ; ce type de technique
fut pauvrement représentée cette année.
La 3D constitue la technique d’une grande part des films actuels,
mais les bonnes vieilles recettes de marionnettes, dessin,
modelages continuent de servir nombre de propos d’auteurs.
La pixillation (technique
de tournage image par image) eut les honneurs du festival
avec deux programmes particulièrement intéressants,
où l'on put découvrir le superbe film norvégien
de Morten Skallerud, Un an le long de la route abandonnée,
long travelling avant dans un paysage désertique que
la pixillation permet de faire durer à travers les
saisons et dans l’espace. Sans doute le meilleur exemple de
fluidité de cette technique, malheureusement desservie
musicalement par l’insupportable Jan Garbarek.
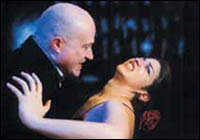 |
|
|
|
Dans le même programme,
on put aussi revoir l’admirable Furniture Poetry, du
toujours inventif Paul Busch, (qui revenait en compétition
avec un remake en pixillation du film Dr Jeckyll et Mr
Hyde, version Spencer Tracy versus Ingrid Bergman, et
repartit malheureusement bredouille comme il y a deux ans),
variation poétique sur la vie cachée des objets
quotidiens (objets inanimés avez-vous donc une âme…).
Dans ces deux films de Busch, la pixillation devient un souci
formel, propre à traduire une interrogation sur la
permanence du réel (Furniture Poetry) ou sur
les identités multiples d’un individu (Dr Jeckyll
et Mr Hyde).
|