La question a de nouveau
été posée en 2002 par la Société
des Réalisateurs de Films (en partenariat avec Les
Cahiers du Cinéma, Le Festival des 3 Continents,
et la maison de production documentaire Les Films d’Ici) à
des cinéastes du monde entier. À charge pour
eux d’y répondre par un film d’une durée de
quelques minutes, auto-produit, et dans la forme souhaitée
par le réalisateur. Les dix cinéastes ayant
répondu à l’appel ont donc présenté
leurs travaux lors d’une séance spéciale, dans
le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs à
Cannes.
Le caractère ouvert
de la question constituait un appel à une liberté
d’invention, en dehors de toute catégorisation esthétique.
En s’adressant à des cinéastes inscrivant leur
travail tant dans la fiction que le documentaire, le projet
s’offrait comme le champ d’expériences singulières,
augmenté de l’exigence d’une forme courte (les films
ne dépassent pas la quinzaine de minutes).
Ainsi Global Coverage,
où la cinéaste palestinienne Leila Sansour choisit
la méthode du documentaire auto-filmé pour mobiliser
autour de la souffrance palestinienne, des " stars ",
sélectionnées selon leur potentiel spectaculaire.
Dans les modalités d’écriture documentaire les
plus contemporaines, le dispositif d’auto-filmage constitue
une forme en vogue, même si son côté " recette "
place la mise en avant du dispositif au détriment du
sujet traité. Ici, l’acte individuel, perçu
comme dérisoire, porte en lui son propre échec.
En suivant les règles du jeu médiatiques, et
ce, jusque dans la forme du film, télévisuelle
et banale, Global Coverage reconduit un sentiment d’impuissance
face à l’écho du monde transmis par les médias.
Le dérisoire est contagieux, et le film ne dépasse
pas l’anecdote.
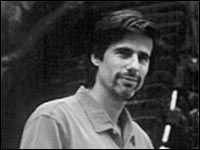 |
|
|
|
Après les médias,
l’omniprésence du cinéma hollywoodien est, bien
entendu, un thème récurrent pour des cinéastes
confrontés quotidiennement à l’homogénéisation
des images. Au point que la relation avec " l’Empire "
s’apparente à une actualisation du mythe faustien,
où L’Appel d’Hollywood, (comme se titre la comédie
de Manu Rewal) enclôt l’engagement artistique possible
dans la nécessité de trancher, d’abord, la tentation
de l’intégration dans le Grand Tout mondialiste. Donner
à voir le conflit entre globalisation et singulier
passe nécessairement par cette reconnaissance de l’intériorité
du conflit. L’Appel d’Hollywood, dans une forme de
sitcom, relègue donc hors champ ce qui fait signe d’altérité
pour le spectateur occidental, pour décrire le dilemme
d’une jeune actrice indienne confrontée à la
proposition téléphonique d’un producteur américain.
C’est dès lors dans une quasi-schizophrénie
permanente que L’Appel d’Hollywood sursaute au gré
des coups de fil, inconstances et dénis de son héroïne.
Plus que son choix final (rester, ou partir), c’est dans la
reconnaissance du mouvement d’oscillation entre deux identités,
jusque dans le dérisoire – sari ou mini-jupes ?
- que le film élabore son propos.
|