|
La puissance de " l’Empire ",
on le sait, repose sur sa capacité à fabriquer
des mythes à la puissance de séduction universelle.
Avec humour, le court-métrage de Walter Salles et Daniela
Thomas, Embaladores, s’inscrit dans une thématique
hollywoodienne classique : la confrontation entre les
" petits " et les " grands ",
entre culture populaire et culture dominante. En nous amusant
avec des improvisateurs des rues, avec comme pont de mire
de leur verve les blockbusters comme Titanic, Salles
met en lumière la capacité de récupération
qui fonde la culture populaire. Paradoxalement, on pourra
regretter que Embaladores n’offre que le " folklorisme "
comme alternative à la " grande menace "
américaine; l’image du Grand Sud reconduite comme un
paysage bariolé, est quasi-identique à ce qu’ont
pu en montrer d’autres cinéastes – on pense beaucoup
à Buena Vista Social Club et son esthétique
de carte postale.
| |
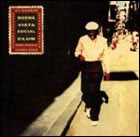 |
|
|
Anak Alal du cinéaste
malais Osman Ali s’inscrit, lui aussi, dans le territoire
des icônes, où s’indistincte la fiction hollywoodienne
et la légende traditionnelle. S’offrant comme l’ombre
d’une idylle impossible entre une princesse-danseuse et un
pauvre clochard, le film de Osman Ali emploie le récit
mythique comme un tamis. L’idylle muette, et par elle une
possible union des cultures, est condamnée d’avance
par la perte d’une gestuelle commune : la danseuse et
son art, le sens contenu dans la codification de ses gestes,
échappe autant au spectateur qu’aux autres personnages.
Le filmage en Super 8 et le dérisoire ludique d’un
symbolisme volontairement stéréotypé
réduisent le récit mythique à une succession
de topos constamment disjoints du réel. Dès
lors, c’est dans les interstices du récit que se dessine
une réalité sordide et désolée.
Faute d’une expression partagée du sentiment, les gestes
et les codes s’éparpillent, le réel se délite.
Jusqu’au meurtre de la danseuse, où l’amant retrouve
des postures de western pour assassiner l’icône traditionnelle.
La réponse peut-être
la plus bouleversante fut celle de Pedro Costa. En trois minutes,
et deux plans (un soldat en armes, au repos, comme hésitant
encore à engager le combat, et l’image d’un nouveau-né)
son film sobrement intitulé Sans Titre accole
le contradictoire, conjugue la brutalité indispensable
à toute résistance et l’espoir tout aussi nécessaire
d’un recommencement.
|