| |
 |
|
|
La lumière
revient dans la salle. Les spectateurs sont émus. On
revient attendri de ce voyage à Saint-Etienne-sur-Usson
dans le Puy de Dôme. Très vite, après
l’arrivée du réalisateur et de l’instituteur,
les questions ne tardent pas à fuser. Tout d’abord,
le problème des classes uniques. Et si c’était
une classe idéale ? Non, pas d’idéalisme,
juste un hommage rendu au métier d’enseignant. Enseigner,
c’est jouer un rôle, du moins dans la vie des élèves,
et il ne fut pas difficile de passer devant la caméra
ainsi, d’autant plus que la classe devait apprendre à
vivre en collectivité avant toute chose. La question
du réel parfois plus fort que la fiction, ensuite.
Nicolas Philibert répond : filmer à bonne distance
tout comme on enseigne à la bonne distance, entre autorité
et affection. La caméra s’est faite invisible mais
pas cachée… C’est une question esthétique et
morale. La confiance naissait à la source du respect.
Ne pas se faire oublier mais discret et attentif. Comment
le tournage a-t-il été présenté
aux enfants ? Eh bien il sont venus voir dans l’objectif
de la caméra les uns après les autres. Jojo
a même déclaré : " ça
y est, monsieur, moi aussi je l’ai vu le film ! ".
Un spectateur enchaîne avec la vision d’un monde en
voie de disparition… L’école de Jules Ferry plutôt
que celle de Luc Ferry… ? Un conte, ce film ? Non,
surtout une histoire de sociabilité, une histoire tout
court même. " Pas d’ordinateurs dans la classe ? "
lance quelqu’un d’autre, en insinuant le passéisme
de cette école rurale. Si ! Il y a cinq ou six
ordinateurs, mais on ne les voit pas dans le film, le montage
a nécessité des coupures, toutes les scènes
n’y sont pas… Ainsi on ne voit pas les cours d’anglais, de
musique, d’arts plastiques… entre autres. Enfin, on parle
de la scène de multiplication. Tout le monde attendait
une remarque à ce propos. Ainsi une femme avoue avoir
ri, mais pas aux dépens des protagonistes, plutôt
avec eux. Pourquoi ? Parce que c’est une situation que
tout parent a vécue. Pour l’anecdote, Nicolas Philibert
raconte : il avait d’abord donné une division,
et comme cela ne durait pas assez longtemps, il a proposé
une multiplication. Toute la famille s’est impliquée,
vu le blocage du garçon. La gifle de la mère
a-t-elle été motivée par la présence
de la caméra ? Peut-être. Il y a du jeu
quand on filme...
D’autres spectateurs parlent ensuite de séparation
à la fin de chaque année scolaire, de la violence
à l’école, pour revenir enfin à la problématique
du vrai et du fictif dans le documentaire : choix d’une
école, du tournage avec des scènes inventées,
du montage des séquences… L’essentiel étant
de faire passer une vérité. La place du producteur
aussi : quelqu’un qui va chercher de l’argent, en France
en tout cas ! Le mot de la fin fut celui de l’état
d’esprit au début du tournage : être complètement
disponible, très intuitif et vierge d’esprit justement.
Aussi important que les deux verbes qui constituent les deux
auxiliaires de la langue française, et qui forment
par là même un titre simple et philosophique,
éclairant en un mot. Surtout à une époque
où les zones d’ombre, destructrices et tyranniques,
gagnent à être mises en lumière pour se
métamorphoser en espace de liberté et de création.
L’avenir des enfants nous le rappelle, sans fin ni cauchemar.
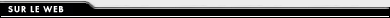 |
|
|
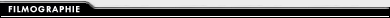 |
|
1978
La voix de son maître (co-réalisé
avec G. Modillat)
1979
Patrons / Télévision (co-réalisé
avec G. Modillat)
1985
La face nord du camenbert
1986
Christophe
1986
y'a pas d'malaise
1987
Trilogie pour un homme seul
1988
Vas-y Lapébie !
1988
Le come-back de Bacquet
1990
La ville Louvre
1992
Le pays des sourds
1994
Un animal, des animaux
1996
La moindre des choses
1998
Qui sait
2002
Etre et Avoir
|
|
|