| |
 |
|
|
Cette rétrospective
offre par contre la chance inespérée d’une réhabilitation
sur pièce du méconnu Ringo Lam, en donnant à
voir les films qui amenèrent Jean-Claude Van Damme
à faire appel à lui pour relancer sa carrière
agonisante…
Considéré dans les années 90 comme le
" frère ennemi " du très
médiatique John Woo, ne serait-ce que parce qu’ils
partagèrent comme corps emblématique de leur
cinéma la star Chow Yun-Fat, Lam fut sans doute victime
d’une minoration systématique de son travail par le
jeu tronqué des comparaisons. Ce qui conduisit à
l’introniser un peu vite " honnête artisan ",
dépourvu de tout génie formel. S’il est vrai
que les liens unissant leurs deux œuvres sont suffisamment
troublants, pour justifier la mise en parallèle de
leurs travaux, confiner Ringo Lam au rang de contre-champ
réaliste de Woo serait oublier un peu vite qu’il fut
parmi les rares cinéastes, au-delà des expériences
éphémères de la " Nouvelle
Vague " hong kongaise du début des années
80, à assumer la posture d’observateur de la société
hong kongaise. Cela se traduira exemplairement dans ces deux
réussites majeures, City on fire (1987) et Full
Alert (1997), où la lassitude de son remplaçant
au box-office Lau Chin Wan se substitue à la grâce
de Chow Yun Fat. Ces deux polars urbains, à dix ans
d’intervalle, apparaissent comme complémentaires dans
leurs approches diamétralement opposées, de
la fiction documentarisante au basculement dans le fantastique,
d’une même problématique : la confusion
morale engendrée par une société fondée
sur l’injustice sociale et la précarité.
Ainsi, pour évoquer Hong Kong, Ringo Lam ne cessera
de donner à voir, avec une minutie patiente et attentive,
des hommes au travail - même lorsqu’ils évoluent
dans des espaces où, par définition, le travail
n’existe pas, remplacé par le désœuvrement forcé (Prison
on fire) ou le reniement de soi (City on fire).
Le travail chez Ringo Lam est l’alternative que s’est forgée
l’humain pour combattre le retour à la sauvagerie de
la loi du plus fort
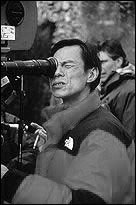 |
|
|
|
D’autre part, la vision de Full Contact, film littéralement
aveuglant à force de vulgarité et de clinquant
revendiqué, contribuera à contenter ceux pour
qui Hong Kong est synonyme de boursouflures formelles. Réalisé
la même année que le Hard Boiled (1992)
de John Woo, déconstruisant le personnage charismatique
et suave qui fit la gloire de Chow Yun-Fat pour en extraire
la substantifique moelle de brutalité et de sadisme,
Full Contact apparaît comme une " décomplexion "
d’un sous-genre, le heroic bloodshed, né du succès
du Syndicat du Crime.
De King Hu à Liu Chia Liang, ce sont quelques-uns
des maîtres de l’Age d’or des années 70 qui
viendront hanter les écrans de la Cinémathèque
de leurs arabesques martiales. Tout au long de la rétrospective,
nous reviendrons donc sur les autres films présentés,
et sur les cinéastes moins médiatisés
qui composent la programmation.
|