Le festival d’Amiens est,
dit-on, le deuxième festival français le plus
connu aux Etats-Unis, après Cannes. Vraie ou pas, force
est de reconnaître que Amiens se fait le refuge, le
temps d’une quinzaine, de l’intelligentsia des cinéastes
et critiques américains parmi les plus respectés.
Difficile de ne pas résister au jeu du carnet mondain,
lorsqu’il fut possible de croiser Monte Hellman, Tag Gallagher
ou encore le rare Curtis Harrington dans les couloirs du festival.
Mais au-delà de l’assouvissement heureux de la curiosité
du badaud du cinéma (Monte Hellman, je le voyais plus
grand…), c’est par son ouverture d’esprit résolvant
la contradiction apparente existant entre une américanophilie
passionnante dans ses re-découvertes, et une attention
au monde exigeante, que le festival d’Amiens s’est imposé
au fil des saisons comme un lieu de plaisirs cinéphiliques
unique dans le paysage des festivals français. Ainsi
le festival se caractérise aussi par son exploration
persistante du cinéma africain, comme en témoigne
un partenariat solide noué avec le Fespaco panafricain.
|
ULMER
| |
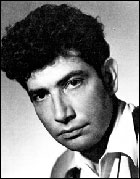 |
|
|
Pour sa 22e
édition, le Festival d’Amiens témoignait à
nouveau de la constance de ses objets aimés, en proposant
un hommage, d’une quasi-exhaustivité bienvenue, rendue
à " l’œuvre " d’Edgar G. Ulmer.
3e hommage rendu en 15 ans d’existence, au " Prince
de la série B ", l’effort force le respect,
à défaut de convaincre de l’importance du travail
d’Ulmer.
Homme de théâtre allemand, étoile montante
à son arrivée aux Etats-Unis mais dont la carrière
fulgurante au sein des studios fut brisée net par une
maladresse amoureuse, Ulmer est un cinéaste errant,
ayant œuvré aux confins du cinéma - itinéraire
à rebours- et toujours dans des conditions de tournage
extrêmement difficiles. La vie de cinéma pléthorique
de cette figure romantique du panthéon macmahoniste
recèle ainsi des arborescences historiographiques d’où
il est difficile de démêler la mythomanie bien
connue de Ulmer et la réalité.
De la filmographie de Ulmer "l’outcast " se
sont longtemps détachés quelques titres, guère
plus d’une demi-douzaine, où scintille le véritable
diamant noir qu’est Detour, étude de la lâcheté
humaine d’une lucidité qui confine au désespoir
le plus absolu, en même temps qu’emblème de la
série " B " comme forme épurée
du cinéma hollywoodien. Ainsi son Black Cat
(1931), qui reste le film Universal le plus étonnamment
moderne de la série, tant la théâtralité
inhérente à la série est travaillée
par une vision du monde à la barbarie glacée,
entre art déco et empreintes des horreurs de la guerre.
 |
|
|
|
Grâce à
l’investigation patiente du festival d’Amiens, des trouvailles
modestes déployèrent un peu plus le talent d’artisan-" miniaturiste "
de Ulmer (pour reprendre un mot de Jacques Lourcelles), où
l’influence de son maître Murnau et les références
persistantes à la culture européenne classique
font écho tout au long de son travail. Ainsi de Strange
Illusions, film d’enquête où l’argument psychanalytique
se teinte de références appuyées à
Hamlet. Cependant, l’auteurisation de Ulmer, à l’heure
où ce concept a déjà fait bien des ravages
dans l’appréhension du cinéma classique, reste
encore une hypothèse que la réalité des
films tend à infirmer.
|