LE PALMARES
| |
 |
|
|
Le mini site Cannes
2002 concocté par Objectif Cinéma comporte notamment
une série de liens vers l’ensemble des films présentés
cette année au festival.
Un petit mot toutefois en introduction pour commenter le palmarès
2002. Le jury était présidé cette année
par David Lynch, entouré de deux comédiennes
(Sharon Stone, Michelle Yeoh), d’une actrice productrice indonésienne
(Christine Hakim) et d’une pléïade de réalisateurs
(Régis Wargnier, Claude Miller, Bille August, Raoul
Ruiz et Walter Salles). On déplorera au passage l’absence
injustifiée dans le jury, depuis plusieurs années,
de techniciens du cinéma (chef opérateurs, ingénieurs
du son) complètement laissés pour compte.
Le Pianiste, grand film classique et personnel de Roman
Polanski, constitue une palme sans surprise pour Cannes, qui
récompense le plus souvent (à l’instar des autres
grands festivals internationaux) des films consensuels et
œcuméniques. Notre palme personnelle à Cannes
cette année s’appelait L’Homme sans passé
d’Aki Kaurismaki. Il se traduit dans le langage du palmarès
par " grand prix du Jury " et " Prix
d’interprétation féminine ", beaux
lots de consolation pour la vitalité désespérée
qui irrigue le nouveau film du cinéaste finlandais.
Le prix d’interprétation masculine récompense
Olivier Gourmet, impressionnant dans Le Fils des frères
Dardenne.
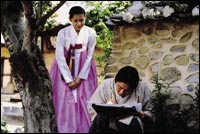 |
|
|
|
Certains attendaient
un prix politique ex-æquo, regroupant les œuvres de
l’Israélien Amos Gitai (Kedma) et du palestinien
Elia Suleiman (Intervention divine). Il n’en fut rien,
et c’est ce dernier qui récolte un prix du Jury mérité
quand on repense à son film burlesque et pertinent.
Rumeur, décidément, quand tu nous tiens… Ivre
de femmes et de peinture, nouveau film du Coréen
Im Kwon-Taek, a longtemps été placé bien
en tête des pronostics des festivaliers bien informés.
" Le jury a adoré ", murmurait-on
ici et là… Résultat des courses, il se retrouve
bizarrement tout penaud à partager le prix de la mise
en scène avec Paul Thomas Anderson (et son nonchalant
Punch Drunk Love). Les mystères de la Croisette
sont décidément bien impénétrables !
Idem pour la Caméra d’Or : pourquoi récompenser
le gentillet Bord de mer de Julie Lopes-Curval et donner
une simple mention à Japon de Carlos Reygadas,
film contemplatif, certes roublard mais autrement plus ambitieux
que la chronique des habitants d’une station balnéaire !
La tendance " documentaire " de cette
nouvelle édition du festival ne fut pas absente du
tableau d’honneur, avec le prix du 55ème
anniversaire attribué à Michael Moore pour Bowling
for Columbine, film aussi peu aimable qu’il fut aimé
par les spectateurs.
Restait enfin à décerner un dernier prix de
consolation : meilleur scénario pour Sweet
Sixteen de Loach (en meilleure forme artistique depuis
bien longtemps).
| |
 |
|
|
L’embarras du choix
exprimé par le jury était bien facile à
comprendre, étant donné le niveau de qualité
de la sélection 2002. Les films de Sokurov (Russian
Ark), Cronenberg (Spider), Jia Zhangke (Plaisirs
inconnus) auraient très bien pu se retrouver au
palmarès, tout comme certains films présentés
curieusement " hors compétition "
(les magnifiques Être et avoir de Philibert et
Femmes en miroir de Yoshida). Et la sélection
française dans tout ça ? Elle n’a rien
reçu… Comme d’habitude ! Ce n’est pourtant pas
faute d’avoir gentiment montré son éclectisme,
entre le mélodrame de Robert Guédiguian (Marie-Jo
et ses deux amours), le film high-tech d’Assayas (Demon
Lover, hué par de nombreux journalistes), l’objet
prétentieux de Gaspar Noé (Irréversible)
et l’œuvre ouatée de Nicole Garcia (L’adversaire).
Les clôtures des festivals de Cannes sont toujours étranges :
les films présentés juste après les cérémonies
du palmarès sont souvent là pour nous faire
oublier notre mélancolie du départ pour Paris.
Mais en fait, c’est souvent le contraire qui se passe. Ce
fut le cas par exemple, cette année, avec la présentation
du nouveau film de Claude Lelouch. Bien qu’on ne soit pas
de ceux qui tirent à bout portant sur le cinéaste
depuis trois décennies, il faut bien admettre qu’il
n’y a pas grand-chose à dire de positif de And now
ladies and gentleman, synthèse mollassonne du cinéma
lelouchien, agrémenté d’un tandem béat
et catastrophique, Patricia Kaas et Jeremy Irons. L’ennui
nous gagne tellement qu’on finit par penser à autre
chose, et à s’angoisser de quitter cette planète
cinéma paradoxale et attachante qu’on nomme depuis
plus d’un demi-siècle, Festival de Cannes.
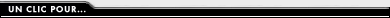 |
|
|