DE LA MORALE EN TOUTE CHOSE
Valladolid en Espagne ou
le sérieux respectueux d’une terre (la Castille) qui porte
et arbore tout le poids (historique et symbolique) de son
passé par ses nombreuses églises et monuments restaurés. Quarante
septièmes éditions d’un festival à la fois rigoureux et concis
dans sa capacité à ne point céder sur l’artificiel promotionnel
(le strass chic et choc n’avait pas sa place, même si parfois
il s’avère agréable quand il n’occupe pas tout le champ du
visible) pour privilégier une cinématographie en prise avec
le monde. La soirée d’inauguration a donné le la dans
ses intentions mais aussi ses attentes avec la projection
du film de commande 11’09’’ 01. Ou comment le cinéma
se doit de transmettre des éléments de réponses à un état
du monde qui ne va pas. Il y a là un devoir assez terrible
assigné aux cinématographies transformées en slogans
humanitaires à l’échelle mondiale. Pourtant, c’est une belle
idée que d’aller demander le geste singulier du cinéaste,
une commande d’amour du et pour le cinéma où l’on reconnaît
les puissances de cet art industriel. Nombres de cinéastes
se sont engagés au nom d’une idée (que ce soit Chaplin pour
l’effort de guerre aux U.S.A en 1917 avec The Bond
ou Nicolas Philibert avec le Collectif des Sans Papiers
en 1996.) L’histoire du cinéma peut se lire sous cet angle
de la commande et de la propagande et Eisenstein restera à
jamais le cinéaste de l’humaine condition (une pensée charnelle
dans tout son cinéma) avant tout et non uniquement le chantre
d’une idéologie.
| |
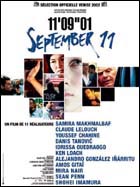 |
|
|
Or, à Valladolid, à coté
d’œuvres d’exception tel Le Fils des frères Dardenne,
Rachida de Yamina Bachir-Chouikh ou le dernier film
du tandem Guédiguian Ascaride Marie-Jo et ses deux amours,
peu de geste de cinéma dans ce que proposait la sélection
officielle mais de la pédagogie où les salles de cinéma sont
considérées comme autant d’urnes citoyennes. Le film pédagogue
d’une conscience claire civique, véhiculant les meilleurs
intentions du monde, a le vent en poupe, où la naïveté du
propos l’emporte sur les puissance du cinéma. Il faut du réconfort
et l’enfant sera toujours le porteur du rêve et de l’innocence
(le gamin surdéterminé d’Ultimo Tren de Diego Arsuaga,
prix de la première œuvre Pilar Miro, prix du meilleur
acteurs pour ses trois comédiens Federico Luppi, Hector Alterio
et José Soriano). Des papys héros (version latine machine
à vapeur de l’opus eastwoodien étoilé Space Cowboy)
de cette aventure charmante de la lutte d’un idéal contre
la mondialisation incarnée par un jeune homme d’affaire hollywoodien.
Une révolution de notre temps : à la fois douce (contre sens
terrible) nostalgique et déjà vaincue. Larry Clark milite
aussi pour une émancipation du corps, totalement vampirisé
par la cellule familiale, l’horreur par excellence chez lui.
Ken Park son dernier film tombe comme une jeune fille
mal troussée à qui on aurait promis monts (la liberté) et
merveilles (les plaisirs) et qui ne découvre pour la énième
fois que quelque chose de commun, banal voire réactionnaire
(le jeune toujours beau, l’adulte toujours le vieux con largué
quand il n’est pas violeur…) Quelques éclats surgissent du
jeu de ses comédiens, notamment le jeune punk Shawn (interprété
par James Ransone) Le fil rouge de la pensée est si lisse,
évident, et conventionnel que l’on tente en vain de dénicher
quelques éclats. Oublions l’autre summum du ridicule avec
le dernier film australien de Rolf de Heer The Tracker,
tentative ratée d’une filiation baroque – abus d’une musique
redondante histoire d’enfoncer plus encore les clous, inefficace
emploi de la picturalité « kitschisant »(barbarisme
assumé) tout le film voulant se réclamer de Leone. Raté.
Le pire fut atteind avec l’abominable film Ararat d’Atom
Egoyan. Point limite boursouflé du système cinématographique
du cinéaste (la mise en abîme, la distanciation réflexive,
l’image de l’image comme vecteur d’une mémoire parcellaire,
le secret derrière la porte en somme) son dernier film s’effondre
dès lors que la représentation de l’horreur et la barbarie
d’un régime (les Turcs coupables de génocide envers les Arméniens)
est placée sous le seul et évident signe du règlement de compte.
Lorsque l’argument esthétique et politique du cinéaste consiste
à dire que fils de et père de, il y a là une limite certaine ;
non pas celle de l’impudeur. Même pas, car de cela, le cinéaste
n’en a pas le courage (tel Elia Suleiman par exemple avec
Intervention divine.) La limite se situe du côté de
la pauvreté formelle qu’exige cet appel de la mémoire et de
la transmission. Les bonnes intentions louables du cinéaste
accouchent d’un film bête, empêtré d’imageries déjà vieilles
(notamment les scènes de reconstituions tout comme celle du
plateau de cinéma) et de personnages plombés des intentions
humanistes d’Egoyan. A oublier.
|