| |
 |
|
|
Les clans yakuzas, « parties
intégrantes de la société japonaise qui existent depuis le
XVIIe siècle, partageaient à l’origine leurs activités entre
les jeux et le marché noir. Chaque membre accepte la hiérarchie
et se soumet au groupe, l’individu étant prêt à sacrifier
sa vie pour ce qu’il estime être son devoir ». Ce dernier
est bien le pendant du gangster italo-américain, qu’il soit
filmé par Suzuki ou Fukasaku. Chez Kitano il est habillé
par le couturier Yoshi Yamamoto, comme en écho au gangster
scorsesien vêtu en Versace ; le yakusa, pour imposer
le respect, roule toujours les « r ». Kinji Fukasaku
a été le premier réalisateur à se démarquer de l'image du
bon yakusa guidé par l'honneur et la solidarité, pour imposer
celle d'un gangster rongé par la trahison.
Chez Seijun Suzuki, il arrive qu’il évolue en dépit des règles
instaurées, qu’il rompe les interdits du clan. Ainsi les deux
frères de La vie d’un tatoué en arrivent à tuer un
chef yakusa. Le cinéma de Suzuki s’ouvre sur une petite mélodie
japonaise soutenue par des paroles surannées, où se heurtent
l'univers enchanté de Jacques Demy et un cinéma nerveux rappelant
celui de Samuel Fuller. Suzuki n’a mis en scène que des séries
B au sens littéral, il n’a jamais choisi les scénarii de ces
films ni la distribution, dont le faible budget est contrebalancé
par une mise en scène inventive. Fukasaku et Suzuki sont adulés
par Kitano, Tarantino et Jarmusch qui le citent abondamment.
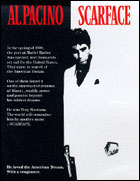 |
|
|
|
Le yakusa kitanesque est
l’archétype de l’anti-héros, froid, décidé et flegmatique.
Dans Sonatine, Murakawa veut quitter les Yakuzas.
Selon Kitano : « Au Japon, arrêter quelque
chose est toujours un acte déshonorant. Quand Murakawa est
envoyé à Okinawa, il devine qu'il va se faire assassiner.
Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est ce qui se passe dans
la tête d'un homme quand il sait qu'il va mourir ». Mais
ce qui fait la force de ces films, c’est une mise en scène
truffée d'inventions étonnantes comme dans la scène de Jugatsu
où Kitano camoufle un fusil automatique dans un bouquet de
tournesols. Ce dernier film est ponctué de moments insolites,
après une soirée festive le yakusa Kitano somme son lieutenant
de faire l'amour à sa petite amie. Ce dernier s'exécute sous
les yeux de son chef, mais l'imprévisible yakuza interrompt
leurs ébats, renvoie sa petite amie et essaie de sodomiser
son lieutenant. Plus tard, il ordonnera à son lieutenant de
se couper le petit doigt et frappera sa petite amie pour avoir
obéit à ces injonctions.
Le film criminel illustre et dramatise le rêve américain,
que les films soient américains ou non, la « réussite »
pour le gangster consiste toujours à sortir de l’anonymat
et à se faire un nom. La tragédie du genre est liée à l’isolement
fatal qui suit cette réussite. Le Scarface de De Palma
a mille raisons de nous impressionner et de nous émouvoir,
la moindre n’étant pas le double satisfecit de notre sadisme :
on savoure par procuration le mal que Tony Montana inflige
au monde avant de jouir du mal qui le châtie. Le film criminel
nous atteint au plus profond de l’âme car la destinée du gangster
est une parabole tragique du succès, celle d’un homme qui
ne vit que pour lui-même et en meurt.
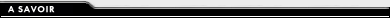 |
|
1) Pour ce qui est de
la thèse selon laquelle une éminence grise travaillant
dans l’ombre, un « master mind » qui
planifie et organise toutes les activités du crime,
on se référera au film de Walsh The enforcer.
2) Scorsese : « I
would like to think that GoodFellas comes out
the extraordinary tradition spawned by Scarface
and The Roaring Twenties ». in A Personal
Journey With Martin Scorsese Through American
Movies, 1997, Faber & Faber, p. 47.
3) Op cit. p.47.
|
|
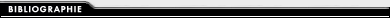 |
|
Le crime organisé à la ville et à l’écran, Etats-Unis,
1929-1951, de Sophie Body-Gendrot, Francis
Bordat, Divina Frau-Meigs, édition Armand Colin,2001
A Personal Journey With Martin Scorsese Through
American Movies, 1997, Faber & Faber.
|
|
|