| |
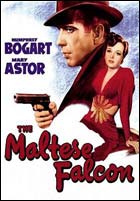 |
|
|
Le film de gangster dans
sa grande décennie « classique » (les années 30)
s’est épuisé à dramatiser le combat du Bien contre le Mal
au sein des contradictions économiques, sociales et idéologiques
de la Dépression et cède sa place au film noir. « Le
film noir renonce à ce combat douteux et, jusqu’à certaines
limites, présuppose l’ambivalence des valeurs -au bénéfice
du mal (The Maltese Falcon de John Huston en 1941 est
le premier film noir) ». Ce sont deux films
de Raoul Walsh, The Roaring Twenties (1939) et High
Sierra (1941), qui incarnent le mieux cette transition.
The Roaring Twenties (programmé durant la journée dédiée
à James Cagney) dresse le bilan du film criminel à l’aube
de la Seconde Guerre mondiale. Il n’est plus vraiment « synchrone »
(Ciment) avec les événements qu’il relate (il inaugure l’usage
de la voix off qui deviendra la marque stylistique du film
noir). Il annonce le crépuscule du gangster en récapitulant
son histoire au miroir du cinéma. Pour Walsh, le gangster
est devenu anachronique. Ce que l’on appelle « film noir »
s’inscrit à bien des titres dans la continuité du film de
gangsters des années 30.
Coppola, Brian De Palma, Cimino, Scorsese, revisitent les
films de gangsters des années 30 en les modernisant (2).
Si pour Rico, Tony, Tom et les autres le succès est moins
une affaire d’argent que de pouvoir, ce que signale le patronyme
de Cagney dans The Public Enemy : « Powers »,
pour les wise guys de Goodfellas, tous tournent
autour de l’argent et du pouvoir. Ils sont des affranchis
dans le but de faire de l’argent. Cela permit à Scorsese
de s’intéresser à la Mafia comme à un groupe social à part,
ce qui fait de sa trilogie sur la pègre davantage une étude
anthropologique que de véritables films criminels.
Goodfellas s’attache à décrypter leur mode de vie et
leur approche non conventionnelle de chaque journée. Henry
Hill (Ray Liotta) sort avec sa nouvelle petite amie au Copacabana.
Ils évitent de faire la queue en passant par les cuisines
et sont placés juste devant le chanteur, les chaises, la lampe
et la table apparaissent presque de façon magique, virevoltant
au-dessus de la tête des clients. Dans toute cette scène,
la caméra suit les deux protagonistes de l’entrée du club
jusqu’à ce que Henry et Karen s’assoient à leur table.
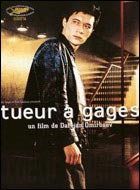 |
|
|
|
C’est aussi la « confrontation
entre «un innocent » et un univers avec ses règles, sa
hiérarchie et ses rivalités » et « souvent,
cette rencontre ne va pas sans heurts, surtout quand l’appartenance
au milieu signifie le don de soi et l’acceptation de pratiques
et de comportements violents. C’est ce qu’apprennent à leurs
dépens les héros de J’irai au Paradis car l’enfer est
ici de Xavier Durringer, Tueurs à gages de Darejan
Omirbaev, Made in Hong Kong de Fruit Chan ou encore
de James Gray ». Howard Hawks affirmait :
« To stay alive or die : this is our greatest
drama» (3). La violence, élément essentiel du genre
est, comme chez Scorsese, une conséquence de leurs statuts
et agissements. La violence y est omniprésente car ses personnages
sont violents, cette pratique a des répercussions irrémédiables
sur leur vie.
Ce cinéma offre une explication saisissante de la vie de ces
groupes organisés, dont les agissements sont intrinsèquement
liés à la nature de la société, que ce soit dans la Mafia
italienne, dans le crime organisé aux Etats-Unis ou chez les
yakuzas japonais. Cette radioscopie des pratiques sociales
d’une certaine frange de la population nous montre le gang
comme une entreprise strictement structurée et hiérarchisée,
et tout conduit à assimiler la représentation du criminel
à celle d’un businessman, le lieu de travail quotidien du
gangster est son bureau, comme pour les yakuzas où les entreprises
sont de véritables firmes structurées ayant des activités
criminelles. Ces institutions criminelles ont pour « domaine
d’activité privilégié de la pègre, le trafic de drogue est
au cœur du film de Steven Soderbergh : Traffic,
dans lequel il s’interroge sur la place de la drogue dans
nos sociétés et nos vies, réussissant à cerner les différents
aspects du problème, du circuit international des trafiquants
à la guerre menée par les gouvernements, sans oublier la dépendance
des consommateurs. »
Maurice Tourneur dans l’étonnant Justin de Marseille
aborde ce thème avec un réalisme étonnant. Francesco Rosi
filme Lucky Luciano, caïd de légende au destin exceptionnel,
qui eut la main mise sur le trafic de drogue dans les années
cinquante. L’argent, au cœur de la guerre, provoque des conflits
où la hiérarchie du gang est contestée en permanence, comme
dans Sonatine où Takeshi Kitano est envoyé pour résoudre
un conflit entre des familles rivales.
|