| |
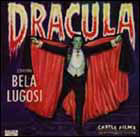 |
|
|
Comme le
rappelle Manuela Dunn Mascetti dans son Chronicles of the
Vampire (1), le vampire n’est pas une simple invention
de l’écrivain irlandais Bram Stoker, mais plutôt une réinterprétation
de plusieurs légendes européennes, dont celles qui entourèrent
le prince Vlad Dracul, et de fables plus anciennes encore.
C’est toutefois après la parution du roman Dracula
en 1897 que le mythe prend forme, et qu’à son tour il influencera
l’imaginaire de très nombreux artistes.
En faisant de son personnage un aristocrate et non pas seulement
un homme du peuple, Stoker a permis bien malgré lui à un faisceau
d’interprétations de se concentrer sur l’image du vampire
devenu symbole d’altérité, celui-ci aura conséquemment suscité
autant de lectures marxistes que freudiennes. Le vampire,
c’est tout autant le riche enjôleur camouflant le cynisme
de ses projets, le prédateur qui saigne littéralement le peuple
en détournant son énergie à son seul profit, que la pulsion
de mort. On ne s’étonnera donc pas que la programmation de
la Cinémathèque étende sa définition du monstre au bourgeois
chabrolien, comme aux simples assassins et aux manipulateurs.
 |
|
|
|
Sous cette
forme, celle, élégante, du vampire dandy et du riche héritier
immortel et épargné par les ans, se dissimule tout ce qui
sait révulser l’homme : la maladie, la décomposition
des corps, la lente désagrégation, tout ce qui rappelle au
monde qu’il est entièrement soumis au cycle du temps. Aristocrate,
fortuné, le vampire de Stoker joue de sa séduction d’hypnotiseur
pour séduire ses victimes avant de s’en nourrir, ou de les
condamner à partager son supplice éternel, en traversant les
siècles sans espoir de rédemption.
Trois périodes dans l’histoire du cinéma montrent son évolution :
la première, celle du Nosferatu de F. W. Murnau (1921),
permettra à l’Allemagne de la République de Weimar d’employer
peut-être pour la première fois le cinéma comme un fantastique
moyen d’expression avant-gardiste ; la seconde, avec
l’avènement des studios Universal, formera l’horreur moderne
avec le Dracula de Tod Browning (1931) ; la troisième,
celle des films de la Hammer, avec le magnifique Horror
of Dracula de Terence Fisher (1958), rendra justice au
roman original en n’occultant plus ses intentions sexuelles,
et mettra à mal les codes de la censure.
Le cinéaste d’abord occupé à l’expression, puis au divertissement
et enfin à la polémique, évolue avec le personnage du mort-vivant
qui l’accompagne dans la découverte de son art et le questionnement
sur sa fonction de metteur en scène.
|