| |
 |
|
|
Dans la même veine critique,
mais dans un registre différent, on peut également toucher
deux mots de La Raison du plus fort, de Patric Jean :
travail « engagé », bien entendu, et qui tente,
par un balayage de grandes villes belges et françaises, de
mettre en lumière les mécanismes, punitifs, de criminalisation
de la pauvreté. On pense à Bourdieu et à Foucault. On pense
aussi, et peut-être surtout, à Wacquant, dont le livre Les
Prisons de la misère trouve ici une mis en images convaincante.
Le résultat ? Un film à la fois travaillé, « écrit »
et terriblement factuel. « Qu’est-ce que nous sommes
en train de faire ? » demande à la fin un Patric
Jean inquiet des ravages sociaux causés par notre modernité
punitive.
Autre grand moment de ce cru 2003 : le documentaire africain.
Il y fut question des rapports entre passé et présent, entre
quotidien et histoire, avec toute l’horreur et la souffrance
que ce mot peut signifier pour l’Afrique.
Cette dialectique, le réalisateur sénégalais Moussa Touré
l’interroge dans deux films magnifiques, différents dans leurs
thèmes et pourtant intimement – et étrangement – liés. Poussières
de ville suit un groupe d’enfants dans les rues de Brazzaville.
Livrés à eux-mêmes, ils vivent d’expédients et dorment sur
un marché. Nous sommes nombreuses donne la parole aux
femmes violées pendant les guerres qui ont ravagé le Congo
Brazza entre 1993 et 1999.
 |
|
|
|
Moussa Touré a souhaité
utiliser l’expérience du premier documentaire pour aider les
enfants de Brazzaville à revenir dans leurs familles. La fin
du film est consacrée à ces retrouvailles et on reste frappé
par la froideur, presque l’indifférence, avec lesquelles sont
accueillis ces enfants. Ce sont ces retrouvailles glaciales
qui sont à l’origine du deuxième documentaire de Touré :
peut-être ces enfants sont-ils des enfants de la guerre, des
enfants de viols… Une hypothèse qui donne lieu à des entretiens
souvent déchirant et qui disent toute l’abomination de cette
violence. Quelle en est le fondement (politique, historique,
sociologique, anthropologique…) ? Où ce désir de viol trouve-t-il
son origine ?, interroge Touré. Est-ce la guerre ? Est-ce
l’homme ? Questionnée, une victime reste sans vraie réponse.
Et nous avec.
La violence et la mort, enfin, son également au cœur du petit
bijou, tout pétri de souffrances et étrangement passé inaperçu,
que constitue Un Mal fou, de Marianne Gosset. Film
difficile et d’une intensité rare sur les rapports entre une
mère et une fille qui n’aura reçu d’elle qu’absence, manque
et folie. Un Mal fou raconte cette histoire, celle
d’une femme qui crève de sa mère, de sa parole, de son amour
et de sa haine. A la mort de cette mère honnie, comme souvent,
des secrets sortent de leur placard : viols, suicides, enfants
cachés… Et ce n’est qu’à ce prix que le deuil peut commencer.
Un documentaire qui sonne comme une prise de parole, jusque
là confinée, confisquée, étouffée, sans doute, par une souffrance
trop intense…
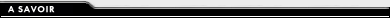 |
|
1) Du nom d’un cinéaste bolchevique, Aleksandr
Ivanovitch Medvedkine. Peu après la Révolution
d’Octobre, il avait installé un studio dans un
train pour sillonner l’URSS et montrer ses films
aux paysans et ouvriers soviétiques.
|
|
|