 |
|
|
|
Tel fut du moins l’avis
de Yossef Tommy Lapid, aujourd’hui ministre issu du parti
« laïque » Shinouï, et à l’époque directeur de la
Télévision publique israélienne. Beit a été censuré,
et la version projetée au Centre Pompidou est un kinéscopage
d’une VHS piratée par l’auteur. Au moment où les premiers
livres des nouveaux historiens israéliens commençaient à peine
à être publiés par des éditeurs privés, il était sans doute
délicat, pour une institution nationale israélienne, de montrer
des images susceptibles d’ébranler à ce point l’inconscient
collectif des Israéliens. Eux dont les pères avaient expérimenté,
bien plus radicalement et à une toute autre échelle, l’horreur
indicible de ce que signifie être employé, physiquement, à
son propre anéantissement.
Appuyer là où ça fait mal, interroger la construction israélienne
dans ce qu’elle a à la fois de plus concret et de plus problématique,
tel était sans doute l’un des objectifs que s’était fixés
Gitai. Vingt ans après Beit, dans la fiction
Kippour, il dérange à nouveau en déboulonnant le mythe
du guerrier israélien héroïque de 1973, pour montrer des jeunes
soldats en proie à des sentiments très humains. Peur, lassitude,
solitude au milieu du champ de bataille, en fait une vaste
mare de boue striée par le passage des chars. Impuissance
des hommes plongés au cœur d’une gigantesque machine de guerre
qui les dépasse. De même que le bruit des canons et des pales
d’hélicoptère, se propageant de part et d’autre de la salle
de cinéma, embarque le spectateur au cœur d’un carnage qu’il
ne comprend pas.
| |
 |
|
|
Ce parcours où le réel est
enregistré dans sa progression au fil du temps, et parfois
transcendé par la fiction, est paradoxal, surtout si on le
compare au travail d’un autre penseur, palestinien celui-ci,
né deux ou trois ans plus tôt dans la même ville de Haïfa.
En avril 1948, Elias Sanbar, encore bébé, doit fuire la ville
avec ses parents devant la terreur exercée par les milices
sionistes. Etudiant en France, il se lance dans un long travail
d’historien dont chaque opus, loin de chanter les dithyrambes
d’une patrie mythique à reconquérir, semble vouloir ancrer
celle-ci dans le temps. En 1994, un an après les accords d’Oslo,
il intitule Les Palestiniens dans le siècle le court
essai qu’il consacre à l’histoire de son peuple dans la collection
« Découvertes » de Gallimard. « Nous avons
été poussés hors de la géographie, il ne faut pas que nous
sortions du temps », écrit-il dans le dernier chapitre,
citant un argument que Yasser Arafat avait livré à ses troupes
en 1991 pour les enjoindre à entamer des pourparlers de paix.
Amos Gitai, lui, n’a pas cette angoisse. Il est dans la place,
la géographie lui appartient et il se contente plus ou moins
tranquillement d’en enregistrer les transformations sous l’effet
du temps. Et comme cela ne suffit pas, comme ce qu’il y voit
lui semble laid, il lui faut encore amender ce travail par
une œuvre de fiction. Peut-être, selon le mot de Bazin, afin
de substituer à son regard un monde qui s’accorderait davantage
à ses désirs d’Israël : où le guerrier de Kippour
ne serait pas un héros d’airain mais un homme blessé qui panse
ses plaies dans l’acte d’amour ; où Israël ne se distinguerait
pas de ses voisins arabes par la force qu’il leur impose mais,
dans des films comme Alila ou Kadosh par exemple,
par la liberté qu’il est capable d’offrir aux femmes qui ont
le courage de la prendre.
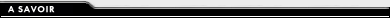 |
|
Centre Pompidou
Salles Cinéma 1 et 2
Esplanade Beaubourg
75004 Paris
Métro Rambuteau
Tél. 01 44 78 12 33
Infos
Du mercredi 1er octobre au lundi 3 novembre
Tarifs : 5 euros, tarif réduit 3 euros
|
|
|