Du 3 au 8 novembre, la
Ménagerie de verre accueilli les auteurs et les spectateurs
d’un étrange festival, mêlant cinéma, projections interactives,
performances de corps et d’images. Entre créations contemporaines
et œuvres déjà historiques, le festival a tenté de nous présenter
un large panel des différentes interactions entre l’image
(au sens large, c’est-à-dire tout stimulus visuel) et le son.
|
|
| |
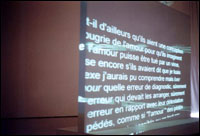 |
|
|
L’installation elle-même
donnait toute son ampleur à cette manifestation. La Ménagerie
de verre, vaste lieu semblable à un puzzle, au nom poétique
et sonore, rappelant à nos mémoires d’enfants les premières
lectures, les premiers fantasmes, abritait dans chacun de
ses recoins des installations permanentes ou éphémères, jouant
avec toutes les possibilités architecturales, couloirs étroits,
salle de danse nue, hangar froid et blanc, miroirs… Ainsi,
dans une même soirée, on pouvait passer du rez-de-chaussée
à l’étage, du hangar qui nous confinait dans un espace large
mais fermé à la salle de danse qui démultipliait l’image par
son mur-miroir.
Chacune des soirées du festival donnait au spectateur différentes
possibilités de vision, tour à tour actif ou passif, simple
regardant d’images projetées, parfois inséré dans le dispositif,
ou même complètement actif, garant du bon déroulement de la
projection, investi du plus grand pouvoir qui soit, celui
de la création, prenant en charge l’intérêt de l’œuvre proposée.
Sans spectateur, pas de dispositif, pas d’intérêt.
C’est bien ce que semblait vouloir nous dire l’ensemble du
festival et de ses œuvres, car l’enjeu de tout ceci était
bien la perception, et le spectateur était amené à se demander
en permanence qu’elle était la bonne façon de percevoir les
projections qui l’entouraient. Les sens de lecture sont-ils
réellement aléatoires et infinis selon chaque individu, ou
y a-t-il un seul sens de lecture, les spectateurs sont-ils
tous régis par les mêmes réflexes visuels ?
 |
|
|
|
Deux dispositifs ont pertinemment
posé la question : les installations à écrans multiples,
et la performance de Yann Beauvais.
La première soirée à la ménagerie nous proposait des installations
à écrans multiples, allant du split-screen classique bien
connu des cinéphiles et maintes fois utilisé par les cinéastes
de fiction (Brian De Palma en tête), à une multiplicité d’écrans
phénoménal (cinq pour une installation de Yann Beauvais),
ou à la superposition d’écran (une image plus petite dans
une image plus grande), et à la séparation pure et simple
de deux écrans qui se font face (impossible dès lors d’accéder
à la position « normale » du spectateur face à l’écran,
puisqu’un autre écran a pris notre place). Comment percevoir
ces différentes images ? Décide-t-on d’un sens de lecture
conscient ou sommes-nous tributaires de réflexes inconscients
qui mènent tous les spectateurs à percevoir la même chose
au même moment ? La question ne trouvera pas de réponse
ici, bien qu’il semble évident que chacun voit chaque installation
différemment, tout en se retrouvant sur les signaux globaux
des œuvres.
Avec la multiplication d’écrans, le spectateur est créateur
de l’œuvre, puisqu’il a à sa disposition une infinité de sens
de lectures, mais serait-il de trop ?
|