|
L’accueil critique du
film fut mitigé et l’est resté jusqu'à
récemment. A sa sortie, Siegfried Kracauer, entre autres,
lui reprocha d’être plus attaché à la
représentation des conventions visuelles qu’à
l’approfondissement social de la critique des classes qu’il
met en scène. Et derrière les louanges adressées
sans cesse au jeu " moderne " de sa vedette
se dessine en filigrane la critique du cabotinage de Kortner
et du réalisateur qui l’aurait laissé faire.
C’est cependant l’opposition de deux styles aussi différents
qui donne toute sa saveur aux rapports Schön / Lulu.
Si pourtant, dans l’ensemble,
le film a bien énormément vieilli, c’est surtout
en raison de son mélange formel d’expressionnisme (
overstatement ) et de Kammerspiel ( understatement
) ou plutôt de symbolisme et de réalisme, moins
franc que dans les pièces d’origine. Mais il est aussi,
à l’instar de La Passion de Jeanne d’Arc (Dreyer)
le produit hybride et lent (surtout dans sa version restaurée/intégrale)
d’une époque charnière de l’Histoire du Cinéma,
le passage au parlant, époque où de nombreux
cinéastes, au lieu de réaliser des films entièrement
muets ou des films tout à fait parlants, réalisent
des films auxquels la parole manque. La comparaison, en terme
d’aise du cinéaste, de Loulou avec Le
Journal d’une Fille perdue - également connu
sous le titre Trois Pages d’un Journal -
ou de La Passion de Jeanne d’Arc avec Pages
arrachées au Livre de Satan, films résolument
muets, est, de ce point de vue-là, tout à fait
éloquent. Ce n’est pas tant le fait qu’il s’agisse
de l’adaptation d’une pièce de théâtre
qui gêne Pabst aux entournures, mais le fait qu’il y
a finalement moins à montrer que ce qu’il montre. Le
film est très découpé, il abonde en plans
et raccords de regards, mais cette multiplication muette de
champs-contrechamps expressifs paraît déplacée
en raison de l’absence de renoncement total au dialogue. Le
cinéma muet a besoin de la mise en scène des
regards, le cinéma parlant peut, à la limite,
s’en passer. Loulou est découpé comme
un film muet, mais mis en scène comme un film parlant.
Et, en tant que tel, il se serait suffi d’une centaine de
plans en moins.
| |
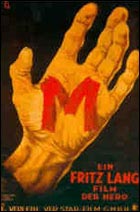 |
|
|
Ce qui n’a pas vieilli,
finalement, c’est Louise Brooks. Ce n’est cependant pas Louise
Brooks par la grâce de la seule Louise Brooks, comme
beaucoup de ses adulateurs ont pu l’écrire, mais Louise
Brooks par la grâce de Georg Wilhelm Pabst, qui a eu
la bonne idée, non pas de la diriger geste par geste
et regard par regard mais, comme l’actrice en témoigne
elle-même, de lui laisser la bride sur le cou, après
l’avoir, au préalable, mentalement mise en condition
à chaque nouvelle séquence. Ce parti-pris, " Actor’s
Studio " avant l’heure, fut d’ailleurs facilité
par le fait que Louise Brooks ne parlait pas un mot d’allemand
et que ses partenaires ne comprenaient pas l’anglais.
Notons enfin que le plan
de l’ombre que Jack l’Eventreur projette sur une affiche le
recherchant a inspiré, bien entendu, le plan équivalent
de M. le Maudit.
Et puis, finalement, une
question que personne, à ma connaissance, n’a encore
pris la peine de creuser : que signifie exactement cette
menorah, ce chandelier à sept branches bien
en évidence à l’arrière de nombreux plans,
que Schön possède chez lui ? Est-ce le signe
d’une judéité superficielle, Schön représente-t-il
le type même du Juif allemand - et plus encore :
berlinois, justement - totalement assimilé, parvenu
et bourgeois, qui, tout en cultivant quelques ultimes symboles
visuels de la foi de ses ancêtres, est obsédé
par le fantasme d’une " rédemption "
définitivement déjudaïsante offerte par
le sexe de la femme non-juive ? Pabst n’était
pas antisémite et le personnage de Schön n’a rien
de grossièrement caricatural : il est plutôt
pathétique. Est-il, lui aussi, un de ces Juifs allemands
si obsédés par leur auto-germanisation au point
de devenir aveugle à la réalité des menaces
nazies ? Dans un film où, enracinement dans le
muet oblige, la symbolique des objets reste forte, une menorah
au domicile d’un grand bourgeois du Berlin d’avant-Shoah n’a
rien, mais alors rien d’innocent.
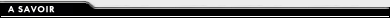 |
|
|
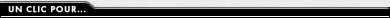 |
|
|