| |
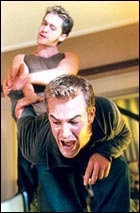 |
|
|
Sans ses figurants stars et son name-dropping
permanent, que restera-t-il du chef d’œuvre de Bret Easton
Ellis ? Là aussi, on aurait pu imaginer ce qu’en aurait
fait un Paul Verhoeven, qui aurait convaincu pour l’occasion
Sharon Stone de venir servir un verre au héros avant de disparaître
aussitôt.
En attendant, le casting des Lois de l’attraction est
plutôt cohérent : James Van Der Beek, le Dawson
de la télé, dans un contre-emploi total et toute une pléiade
de jeunes et beaux comédiens qui vont perdre leur innocence
dans cette spirale de sexe, de drogue et de violence. Avary
lui-même décrit son film comme « l’anti American Pie »,
et il est vrai que le résultat est plutôt concluant.
L’autre difficulté était de rendre le point de vue éclaté,
puisque chaque personnage parle à la première personne dans
les chapitres du livre, donnant sa version d’un évènement,
parfois contradictoire avec celle d’un autre personnage y
ayant assisté. Roger Avary invente alors un système astucieux :
il rembobine le film à la fin de chaque scène avant de changer
de point de vue, pour bien signifier qu’on passe à un autre
personnage mais dans la même temporalité.
 |
|
|
|
Tout commence donc pour le mieux, même si
le manque de tension dramatique est plus difficilement surmontable
au cinéma qu’en littérature. Ainsi le milieu du film sonne
un peu creux et les délires « Pulp Fictionniens »
d’Avary (le personnage du dealer surexploité et sans grand
intérêt) viennent un peu plomber la continuité. Dommage également
que l’histoire d’amour entre les deux personnages masculins
Paul et Sean soit complètement passée à la trappe pour ne
conserver que l’attirance du premier pour le second.
Reste l’essentiel, à savoir la description poignante du désespoir
sentimental dans lequel sont plongés ces étudiants noyés dans
l’alcool et la drogue pour éviter de se confronter à la réalité,
pour tenter d’échapper à l’inévitable Loi de l’attraction.
Une attraction physique qui, dans cette spirale d’autodestruction
amènera chacun à sa perte. Ce spleen générationnel transpire
parfaitement dans le film, qui joue de tous les effets pour
nous faire partager l’absurdité des relations qui unissent
les personnages, cet instinct qui les pousse les uns vers
les autres, sans qu’ils ne parviennent jamais à entrer en
symbiose.
| |
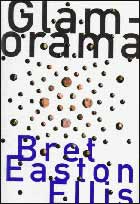 |
|
|
Enfin le cinéma parvient à s’emparer de
l’essence d’un roman de Bret Easton Ellis dans un film certes
inégal mais tout de même très excitant. On découvre également
le comédien qui devrait tenir le rôle principal de Glamorama :
le sublimissime Kip Pardue. En effet, le personnage, Victor
Ward, sera le même que dans Les Lois de l’attraction,
une dizaine d’année plus tard.
Roger Avary saura-t-il réitérer son exploit et réaliser l’impossible ?
La tâche ne sera pas aussi aisée et même si on souhaite y
croire, on se demande comment il pourra réduire ce pavé de
cinq cent trente pages en deux heures de film sans en écraser
la substance.
Réponse en 2005.
|