Le cinéma indépendant américain s’intéresse
ces temps-ci d’une manière particulièrement appuyée à ce qu’il
est convenu d’appeler les kids. On parlera par commodité
de jeunes ou d’adolescents en remarquant dés à présent que
le terme « kid » réfère à une population plus large
allant des prémisses de l’adolescence à celles de l’âge adulte.
Jusque très récemment, divers documentaires ou fictions librement
adaptées de faits réels ont directement adressé le sujet en
traitant de ces jeunes individus non pas nécessairement comme
des personnages mais plutôt comme les témoins d’un monde bel
et bien réel. Leur corps, leur discours et leurs crises ont
fait l’objet d’une attention accrue, le moindre de leur mouvement
prenant sous le regard de la caméra la valeur de signe sans
qu’on ait pour autant à l’interpréter ni à le faire parler.
Consacré comme l’un des objets cinématographiques privilégiés
du cinéma indépendant américain, l’adolescent ne l’a été que
pour servir du même coup d’emblème sociologique et politique.
| |
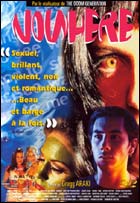 |
|
|
Ce phénomène n’est pas neuf. Il faut en
effet remonter au début des années 90 pour trouver les premiers
films où les jeunes font l’objet d’une étude approfondie.
Sur fond de vague grunge triomphante, Gregg Araki tourne
The livin’ end. Inscrivant son film dans la longue
tradition des road-movies, il adopte d’emblée un discours
radical en mettant en scène deux séropositifs en route vers
leur propre fin. Le propos est clair : no future.
Les 90’s renouent avec le mot d’ordre du mouvement punk dont
les adolescents se font, sans nécessairement en avoir conscience,
les portes drapeaux. Un seul détail les différencie de leurs
pairs : ils n’ont plus le sentiment d’appartenir à une
quelconque communauté et ne revendiquent plus rien, se contentant
de subir ce dont ils n’ont fait qu’hériter (le sida, le krach
boursier de 1987 consécutif de la libéralisation du marché,
la crise de la société de consommation). The Livin’ end
annonce déjà la « Teen Apocalypse » trilogy qui
reprendra les thèmes de la drogue, du sexe et surtout de la
mort. Nowhere, le dernier opus de la trilogie
nie sur un ton définitivement post-moderne les lieux, les
genres, les époques et du même coup l’avenir. L’adolescent
se fait le héros (héraut) d’une société en décrépitude, sa
propre fin préfigurant celle, fantasmée, du reste du monde.
De fait, Araki s’affirme, à travers ses fresques nihilistes
et baroques, comme le premier réalisateur à exprimer à travers
les jeunes le malaise qui frappent l’ensemble de la société.
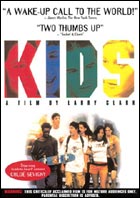 |
|
|
|
De l’autre côté des Etats-Unis, Larry Clark
sort en 1995 le désormais célèbre Kids. Écrit par un
jeune garçon (Harmony Korine n’a
alors que 19 ans) et interprété par des adolescents encore
mineurs, ce film traite presque exclusivement d’eux. Kids,
et par la suite Another day in paradise, Bully
et Ken Park, parlent chacun à leur manière de la crise
que traversent les jeunes ; une crise qui, loin de s’expliquer
seulement par leur âge, traduit quelque chose de plus profond,
de plus grave aussi, dont ils ne sont en définitive que des
symptômes. Car c’est bien d’un symptôme qu’il s’agit, des
rues de New York aux maisons de Tulsa (la ville où se déroule
Gummo), l’adolescent est l’ultime produit d’un monde
dont il accuse le dérèglement. Il suffit de songer à Harmony
Korine qui, jouant le rôle d’un adolescent dans son premier
film, passe en revue les lourds antécédents de sa famille
pour rendre compte de son malaise présent. Seulement il n’est
question dans Gummo ou Julian Donkey Boy, que
de l’Amérique marginale, celle des freaks livrés à eux-mêmes
et que personne n’intéresse. De même Terry Zwigoff dans Ghost
World, traite davantage des jeunes nerds que
des kids en général. Or le kid, entendu comme symptôme,
n’est pas seulement le produit de la pauvreté ni de l’isolement
(le freak et le nerd sont en ce sens des sous-catégories
du kid) mais d’un problème plus large et diffus qui,
ignorant les classes sociales comme la géographie, affecte
l’ensemble des Etats-Unis.
|