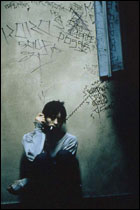 |
|
|
|
On distingue à la fin des années 1990 et
au début des années 2000, deux grandes catégories de kids.
Les adolescents (réels ou attardés) d’Araki et Clark tout
d’abord qui - bavards - se définissent par le verbe, et la
manière dont ils consomment à la fois les produits et les
corps. Le sexe, pour eux, est l’exutoire par excellence, le
lieu où se traduit la déviance et celui qui sert de refuge.
On retrouve ce genre de personnage dans le Requiem For
a Dream d’Aronofsky au début des années 1990, qui traite
également de la déviance sous le prisme non plus du sexe mais
de la drogue et, toute comparaison gardée, dans le récent
Thirteen signé par Catherine Hardwicke.
Une autre catégorie de kids voit parallèlement le jour. Sorti
en 1999, American Beauty de Sam Mendes ambitionne
de dresser le portrait inquiétant de la société américaine
en prenant une famille type de la classe moyenne. Le jeune
Ricky Fitts, le voisin des Burnham, est le seul personnage
muet et réellement décalé de l’histoire. Bien qu’il semble
avoir les idées un tant soit peu claires, il fait figure d’extraterrestre
(ou est décrit comme tel dans un film, il est vrai, assez
caricatural). Il est celui qui, par son silence, atteste d’une
fêlure. Son refus de dire sert de hiatus dans l’histoire,
un hiatus cousu de fils rouges dont Mendes se sert pour exprimer
ce que lui-même ne comprend pas et qui échappe aux personnages
du film. Se servir du silence de l’adolescent pour délivrer
ce qui réellement compte dans un film, c’est exactement ce
que fait Matthew Ryan Hoge dans son dernier film, The
United States of Leland. Ce titre indique d’ailleurs très
clairement le propos du réalisateur : parler d’un pays
à travers la vie et les actes d’un jeune garçon. Le kid
devient l’agent révélateur d’une réalité qu’il exprime inconsciemment.
Il refuse de parler pour la simple raison qu’il est lui-même
ignorant des mobiles réels de ses actes. Il n’est pas pour
autant agi (les mécanismes sociologiques ne sont pas à ce
point marqués), mais traduit une impuissance à dire. Faute
de mots, c’est donc le corps qui parle et qui dit - par son
incapacité à se mouvoir (l’underacting joue un rôle
déterminant dans ce film) - à la fois la difficulté d’être
et l’impossibilité de produire un sens - un « why
» comme le dit Leland. C’est ainsi que le corps de l’adolescent
devient l’outil éminemment politique d’une critique (chez
Mendes, Richard Kelly - avec Donnie Darko
- et Hoge) ou d’une utopie (celle suggérée d’une manière touchante
par Larry Clark à la fin de son dernier film). Le dernier
grand prix de Deauville n’échappe pas à la règle : What
alice found est la chronique naturaliste d’une jeune
fille qui, en donnant son corps, ne fait qu’entériner les
rapports économiques qui régissent sa société. Le corps, dans
tous ces films, ne parle plus - les réalisateurs évoqués plus
haut croient suffisamment en lui pour se contenter de l’observer,
de le suivre patiemment (Gus Van Sant, dans Elephant
n’aspire à rien d’autre qu’à accompagner les kids)
non pas pour percer son secret mais pour pointer du doigt
les stigmates qu’il porte et les douleurs qu’il endure.
| |
 |
|
|
Le kid – ou comme il est question
dans The United States of Leland – the Sick
Fucking Kid (SFK est dans ce film une catégorie officieuse
qu’utilisent des professeurs de prisons) est peu à peu devenu
dans le cinéma indépendant américain le support d’un discours
critique visant à exprimer au mieux un constat, au pire un
avertissement. Il est la part obscure et dissonante d’un rêve
à la dérive, le rejeton d’une société régie par le dérèglement
et l’anomie. Certains auteurs prêtent à ces jeunes des mots,
d’autres préfèrent filmer leur malaise (apparent ou dissimulé)
sans rien dire, laissant aux seuls faits le pouvoir d’exprimer
une situation qu’ils perçoivent avec d’autant plus d’inquiétude
qu’ils n’en cernent ni le sens, ni même la portée.
Le teenage movie , lorsqu’il laisse
parler les kids (par leurs actes, leurs corps et leurs doutes)
au lieu de les faire parler, n’est plus un divertissement,
c’est un augure.
|