Arsinée Khanjian,
ou "la comédienne fétiche d'Atom Egoyan", comme
on dit peut-être un peu abruptement dans les gazettes
de cinéma. Assistante photographe (Calendar),
parent éploré (De beaux lendemains),
patronne enceinte d'une boîte de strip-tease (Exotica),
cuisinière cathodique exaltée (Le voyage
de Félicia), tels sont les multiples visages d'Arsinée
imaginés par son époux de cinéaste. Aujourd'hui,
pour Ararat, elle est une conférencière
aussi savante de l'Histoire collective de son pays que prompte
à oublier son histoire intime.
Mais Arsinée Khanjian
cache d'autres "secrets", moins médiatiques dans notre
contrée : elle parcourt volontiers les planches du
monde entier (Danser à Lughnasa, 1999) et s'investit
dans la vie culturelle (elle participe toujours aujourd'hui
bénévolement à des associations culturelles
dans le monde entier et a beaucoup aidé la communauté
artistique de son pays, le Canada, en s'occupant notamment
de 1989 à 1994 du Bureau du Cinéma, de la Vidéo
et de la Photographie au sein du Département des Arts
de l'Ontario.)
Arsinée Khanjian,
ou l'éternelle jeunesse d'une femme altière
et brune, qui entre à pas feutrés dans le salon
d'un grand hôtel parisien. Arsinée, la guerrière
au regard noir, qui vient défendre la mémoire
d'un peuple d'Arménie meurtri par un génocide
dont on a trop souvent tu ne serait-ce que le nom.
Ararat, comme le
mont arménien homonyme, l'un des symboles d'un film
emprunt d'un faux classicisme. En effet, si Egoyan utilise
différemment l'image vidéo que dans ses précédents
longs-métrages, s'il laisse percer davantage l'émotion
à travers ses plans, il n'en reste pas moins l'artisan
habituel d'un film-méandres, à la fine abstraction,
où se mêlent des personnages réunis par
un feu vif (de la création, de la mémoire, de
la haine), pris dans des temps différents.
Avec Ararat, évocation
du génocide arménien de 1915 et de ses conséquences,
le cinéaste propose une réflexion sur les traumatismes
qu'engendre l'Histoire et la nécessité de la
transmission pour apaiser les effets secondaires des souffrances
passées.
Dans cet entretien,
Arsinée Khanjian parle longuement de ce film, comme
aboutissement d'un travail personnel et créatif questionnant
sa propre identité.
|
| |
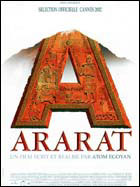 |
|
|
Objectif Cinéma :
Ararat semble plus "classique",
un peu en rupture avec les films précédents
d'Egoyan, tout en préservant les mêmes obsessions
thématiques…
Arsinée Khanjian :
Je ne vois pas de différences dans la forme. Atom a
toujours raconté ses histoires dans différents
temps; c'est le cas de ce film-ci, et de manière peut-être
un peu plus compliqué. Ses structures sont toujours
sophistiquées. Le personnage du peintre, Gorki, est
à cet égard très important, dans un film
qui parle beaucoup de l'absence du père (celui du jeune
homme et de la jeune fille notamment). Gorki adulte symbolise
sûrement quelque chose. Jusqu'à quel point son
apparition est-elle de l'ordre de la mémoire fantasmée
?
Contrairement aux autres films d'Atom, on peut dire que dans
Ararat, les personnages parlent beaucoup et se cherchent.
Le questionnement a toujours fait partie de son travail, mais
là les questions sont identifiées, claires :
une sorte d'auto-analyse s'effectue, mais devant le regard
de l'autre. Le film parle d'un certain non-dit à propos
du génocide arménien. Ce n'est pas un film sur
le génocide arménien dans ses faits historiques,
il n'essaye pas de le prouver : le film traite avant tout
des conséquences du génocide : un négationnisme
total, et pas seulement de la part de la Turquie, à
l'origine de cette tragédie humaine. Il y a eu aussi,
pendant le génocide arménien de 1915, un silence
de la part de la communauté internationale, qui s'est
poursuivi ensuite : tout ce qui avait été officiellement
promis aux Arméniens n'a pas été tenu,
la Turquie a réussi à être impunie pour
les actes commis et les pays occidentaux se sont retirés
de toute responsabilité.
Ararat devrait toucher tout le monde parce qu'il parle
d'une responsabilité qui relève de la société
en général.
|