Pedro Butcher, actuel
rédacteur en chef de la revue en ligne FilmeB, critique
de cinéma pour la Folha de São Paulo lors du
Festival de Cannes 2003, est journaliste de formation. Il
fut critique au Jornal do Brasil, à l’O Globo
et à la Folha de São Paulo. FilmeB est la première
tentative de journal économique sur le cinéma au Brésil.
Dans cet entretien, Pedro Butcher évoque l’histoire récente
du cinéma brésilien et les difficultés auxquelles il a été
confronté. Il fait le point sur la situation à la fois économique
et artistique de l’industrie du cinéma.
|
|
| |
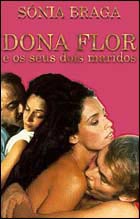 |
|
|
Objectif Cinéma :
Quelle est la situation du
cinéma brésilien aujourd’hui, après le Festival de Cannes
2003 et la sélection de plusieurs films dans différentes sections ?
Pedro Butcher :
On peut dire que le cinéma brésilien
progresse depuis 1997. Dans les années 70, il y avait 3000
salles de cinéma, l’entrée était peu chère et les films étaient
très populaires. Avec l’arrivée de la télévision câblée, de
la vidéo et en raison de certains autres facteurs, le cinéma
brésilien s’est retrouvé en crise ; ce qui a provoqué
la plus grande crise du secteur de l’exploitation, avec la
fermeture de nombreuses salles de cinéma. Ce fut un processus
long durant les années 80 et le début des années 90. La fermeture
d’Embrafilme, organisation régulatrice du cinéma brésilien,
décidée par le Gouvernement Collor de Mello, a parachevé le
tout. C’était une entreprise de l’Etat qui fonctionnait grâce
à des fonds privés provenant des productions et de l’argent
public. L’investissement se faisait ensuite en fonction des
projets présentés, du réalisateur, des moyens de production,
des acteurs.
Objectif Cinéma : Etait-ce
une bonne solution pour le cinéma brésilien, la création d’Embrafilme ?
Pedro Butcher : Ca
été une très bonne solution au départ pour relancer la production,
et puis Embrafilme a aussi tenu le rôle de distributeur de
films. Elle était devenue le nerf du cinéma brésilien, qui
pouvait influencer, gérer le marché et influencer par conséquent
les films produits. C’était une autre époque. Dans les années
1976-78 et au début des années 80, le cinéma brésilien avait
35% de PDM. En 1976, par exemple, Dona Flor e seus dois
maridos de Bruno Baretto faisait dix millions d’entrées.
Chiffre non dépassé depuis. Fin des années 80, Embrafilme
entra dans une crise ; c’était un modèle très fermé qui
privilégiait toujours les mêmes cinéastes. Le président Collor
décida d’arrêter son activité, mais en ne proposant aucune
autre solution. En l’absence d’un nouvel organisme, la production
tomba à zéro film par an, les films prêts ne furent pas distribués,
et le secteur de l’exploitation entra dans une crise encore
plus importante ; à cette époque le cinéma national était
un moyen d’attirer le public dans les salles. Collor, par
un processus d’ « impeachment », quitta le pouvoir
deux années avant la fin de son mandat. Le vice-président,
Itamar Franco, fut nommé président en 1993. Ce dernier créa
immédiatement une loi appelée « Lei do Audiovisual ».
Elle est venue en même temps que la privatisation de nombreux
fonds publics dans plusieurs secteurs et permit la création
de la Loi Rouanet, basée sur le renoncement fiscal afin d’investir
dans le secteur de la culture (théâtre, danse, cinéma, etc.).
Dorénavant, les entreprises ont la possibilité de payer leur
impôt en investissant sur un film grâce à la « Lei de
Audiovisual ». Deux articles de cette loi sont fondamentaux :
le premier, qui offre la possibilité à une entreprise de payer
jusqu’à 3 % de ses impôts (100 % de l’investissement est déduit
des impôts) en l’investissant dans le cinéma. Il s’agit donc
de fonds publics mais c’est l’entreprise qui choisit où les
investir ; le troisième article, qui concerne les distributeurs
étrangers installés au Brésil qui peuvent réduire de 70 %
leurs impôts en investissant dans le cinéma brésilien.
|