|
A l’heure où la Cinémathèque Française semble voir le bout
du tunnel avec l’arrivée de Serge Toubiana à sa direction
(selon Les Cahiers du Cinéma daté du mois de juin 2003,
mais de quel tunnel précisément s’agit-il ?)
Objectif Cinéma a tenu à rencontrer un confrère, très
rarement cité voire oublié, Glenn Myrent. Depuis près de deux
ans, il a véritablement bouleversé la ligne éditoriale
de la revue de la Cinémathèque.
|
|
Revue Cinémathèque , Le
feuilleton du cinéma
| |
 |
|
|
Fondée en 1992 par la Cinémathèque
Française, elle fut dirigée durant plus de 8 ans par Dominique
Paini et Marc Vernet, comprenant dans son comité éditorial
des universitaires de la critique parisienne majoritairement
(Jacques Aumont la figure tutélaire, Michel Marie, Charles
Tesson, Michèle Lagny entre autres). Revue semestrielle d’esthétique
et d’histoire du cinéma, elle a diffusé un savoir exigeant
où l’esthétique était le nerf de la guerre. Ce qui manquait
n’était pas tant l’érudition ou le brio de certaines plumes
analytiques (notamment celle de Nicole Brenez) que le plaisir
du texte pour le lecteur, qui se retrouvait parfois figé dans
une admiration parfumée d’ennui, n’en déplaise aux thuriféraires
du tout interprétatif (dont votre humble critique).
Le parti pris radical du nouveau comité de rédaction (après
le départ de Dominique Paini en l’an 2000) sous l’égide de
Glenn Myrent et Jean-Charles Tacchella fut de rayer la notion
« esthétique » (1) et ce, dès le numéro 19
(printemps 2001, tout ouvrant le lectorat de la revue avec
la traduction anglaise systématique, ce qui n’est pas trop
tôt !) A la lecture de la nouvelle mouture, (à ce jour
quatre numéros, en attendant la reprise ou non avec la nouvelle
direction) première surprise de taille : la revue se
dévore tel un roman et le mot histoire du cinéma
dès lors prend sens de manière quasi charnelle. Il y a un
effet feuilleton qui fonctionne à merveille, où la curiosité
aiguisée par la somme d’informations et de connaissances ramassées
au fil des pages ne s’épuise guère.
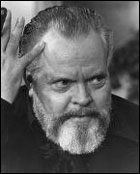 |
|
|
|
Le témoignage et le récit
d’une vie occupent une part importante, comme s’il s’agissait
de faire entendre non pas une parole extérieure (celle du
cinéphile déchiffreur, greffe du savoir et de la pensée) qu’une
parole de l’agir et du vécu. Lorsque que Willy Kurant raconte
Welles, c’est au nom de leur passé commun (l’un cinéaste,
l’autre chef-opérateur) pour dire un temps du cinéma par
sa fabrique. Le lecteur devient le témoin privilégié de
ce qui a été, de cet atelier du cinéma avec ses dessous à
la fois drôles et parfois pathétiques (notamment le destin
de Roméo Bosetti, niçois d’origine italienne, précurseur du
burlesque français dans les années 1910.). Le passage du mot
recueilli à l’écran s’est effectué en toute logique un lundi
de juin au Palais Chaillot. Glenn Myrent poursuivait son
travail de rédacteur, en programmant pour la sortie du numéro
22 de Cinémathèque, une soirée sur Orson Welles et
la Télévision avec la présence de Willy Kurant au verbe réjouissant.
Ce qui demeure est l’attention portée aux travaux des conservateurs
/ restaurateurs du cinéma du monde entier. La restauration,
le patrimoine, l’archive, le document cinématographique sont
traités à la fois sur le mode journalistique et informatif.
Glenn Myrent et son équipe interrogent ce qui reste de la
Kinoteka de Belgrade (indispensable rencontre après la guerre
en ex-Yougoslavie et ses ravages causés, et où aujourd’hui
on peut se poser la question du sort des documents cinématographiques
irakiens) en menant ses enquêtes tels un détective
du cinéma ! A lire le récit (exactitude certifiée des
3050 mots !) des opérateurs Lumière à Chicago, on savoure
une saga policière avec énigme à l’appui. Avec cette sensation
du temps retrouvé qui nous affleure « Ce fut comme
une apparition. J’avais mon doigt sur le bouton de la caméra
à 15 heures 19 et soudain tout changea autour de moi. A travers
le viseur de l’Eclair, je vis cette vieille Grande Roue apparaître
à mesure que le tramway passait par Clark Street (…) j’avais
passé soixante secondes au XIXème siècle – manifestement cent
ans avant ladite minute. »
Le cinéma sous sa plume nous fait devenir proustien.
|