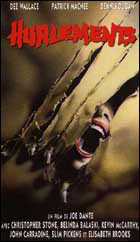 |
|
|
|
Objectif Cinéma
: De manière générale, tout le film
est teinté d’un fantastique discret, confiné...
Emilie Deleuze : J’éprouve
une vraie passion pour le fantastique, aussi bien en littérature
qu’au cinéma. J’étais accro au genre dans les années 70. De
1920 à 1980, mes références sont extrêmement vastes et il
n’y a pas un film qui m’ait échappé. Le film qui m’a le plus
impressionné, c’est Hurlements (Joe Dante, 80). Ce
film n’a rien d’extraordinaire aujourd'hui, mais à l’époque,
il m’avait profondément angoissé. J’adore le personnage de
Freddy Krueger, qui trouve toujours une petite blague avant
de tuer. J’aime aussi son style, ses vêtements, sa façon d’être…
Plus ça va avec le temps, plus je me dis que je deviens froussarde.
Par l’exemple, rien que l’idée de voir des vampires dans une
pub à la télé me procure des frissons. Il est clair qu’en
France, le genre se développe mal parce qu’on le considère
comme mineur. C’est dommage. Aujourd’hui, pour ce qui est
de la novation en matière de fantastique, il faut rechercher
du côté des asiatiques: j’aime beaucoup Ring (d'Hideo
Nakata, 00) auquel tu as fait référence. Je n’ai pas vu le
remake américain, mais je n’ai pas envie de le voir.
Objectif Cinéma : Justement,
son unique intérêt, c’est une scène ajoutée par rapport au
film originel, avec un cheval fou sur un bateau qui fonce
sur le personnage principal. Cela nous renvoie à votre film.
Emilie Deleuze : Oui (sourire).
Je trouve dommage de reprendre ces histoires tellement ancrées
dans le style japonais. Les réalisateurs de là-bas sont très
forts là-dessus. Tu n’as qu’à voir Audition (Takashi
Miike, 01). Quand je suis allé le voir, je ne pensais pas
me retrouver devant un film avec une telle fin, surtout celle-là,
quand on voit le début, très lent, presque à l’eau de rose.
L’héroïne est tellement innocente, habillée toute en blanc…
Insoupçonnable. Si bien que lors des scènes finales, je gloussais,
j’avais le manteau sous les yeux. J’étais profondément mal
à l’aise. A la fin du film, la personne qui était avec moi
est tombée dans les pommes. On s’est assis devant le cinéma
pour reprendre nos esprits, j’ai allumé une cigarette et soudain
le type de l’UGC est venu me voir pour me dire : «On n’a
pas le droit de fumer ici». Et moi, de lui répondre :
on sort d’Audition. Et là, l’homme de changer de ton
: « Ah, alors je comprends, vous pouvez fumer» (rires).
| |
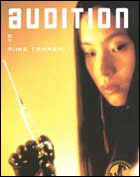 |
|
|
Objectif Cinéma
: Dans votre film, on ressent vraiment
la peur qu’on peut avoir avant d’entrer dans le box d’un cheval.
Emilie Deleuze : C’est exactement
ce que je voulais rendre. J’ai pratiqué l’équitation, donc
évidemment, je me suis servie de mes expériences. Le box du
cheval est un univers à part. L’idée était de montrer comment,
lorsqu’un homme entre dans un box, il est souvent confronté
à un univers bestial, avec des règles en quelques sorte. C’est
valable pour toutes les bêtes. Je voulais insister sur le
fait que ce lieu est régi par des bêtes avant tout. D’ailleurs,
ce serait faux de dire que Mister V. s’humanise dans le film...
Objectif Cinéma : Si
Mister V. ne s’humanise pas, il n’est pas de même pour Lucas
qui, lui, s’animalise: il va même jusqu’à vivre comme un cheval,
en dormant dans un boxe.
Emilie Deleuze : Oui. Pour
lui, le fait qu’il se comporte comme un cheval est le début
d’une longue descente aux enfers. Mais il s’en sort, donc
ça se finit bien pour lui.
Objectif Cinéma : Votre
mise en scène est très étudiée : on part d’une partie du corps
d’un personnage pour le voir par la suite dans son intégralité.
Un peu comme pour le personnage d’Aure Atika dont on voit
les pieds puis tout le corps.
Emilie Deleuze : La mise en
scène est primordiale au cinéma, pour raconter une histoire,
pour situer des personnages. Pour tout. Sans mise en scène,
c’est simple : on n’a pas de film. Ça me fascine d’ailleurs
toujours autant quand on m’explique que la mise en scène passe
après l’histoire. Je ne trouve pas que ce soit exact.
|