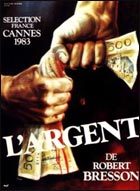 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
Comment vous situez-vous dans la tradition
du cinéma européen et français en particulier ?
Eugène Green : Je ne travaille
pas en référence au cinéma existant. Par exemple, Bresson
m’a beaucoup marqué quand j’étais adolescent, j’ai vu tous
ses films plusieurs fois mais la dernière séance d’un film
de Bresson à laquelle j’ai assisté, avant de réaliser un film
moi-même, c’était l’Argent, à sa sortie, en 1982. Et
j’ai tourné Toutes les Nuits 17 ans plus tard. Quand
on crée, on crée à partir de sa vie, de son expérience, et
l’art fait partie de l’expérience. Une autre référence pour
moi, c’est Ozu, et formellement je ressemble sans doute beaucoup
plus à Ozu qu’à Bresson, mais je ne pense pas avoir emprunté
ou cité des plans de l’un ou de l’autre. On parle parfois
aussi d’Eustache ; ses films m’ont beaucoup marqué, mais
je ne les ai jamais revus : je les ai vus à leur sortie, et
ça fait trente ans. Je ressens donc une affinité globale avec
le grand cinéma européen, disons de 1955 à 1979, je ressens
une affinité naturelle avec certains cinéastes asiatiques,
aussi bien classiques comme Ozu que contemporains comme Hou
Sao Sien, Wong Kar Wai ou Kore- Eda, et puis je m’entends
très bien avec la jeune génération de cinéastes français qui
ont dans les trente ans.
J’ai cessé d’aller au cinéma au début des années 80 et même
j’ai laissé tomber mon rêve de faire du cinéma. Maintenant
je me rends compte que c’est parce qu’à ce moment-là le cinéma
européen a pris un tournant qui m’éloignait de lui. Je trouve
qu’au début des années 90, il y a eu un renouveau, le cinéma
redevient intéressant. Il y a eu l’apport du cinéma asiatique
qui a été très important.
Comme je suis un peu atypique, par mon parcours et par mon
âge, peut-être que je suis, pour ces jeunes cinéastes qui
ont moins de quarante ans, une sorte de martien patriarche,
qui sert de liaison entre le cinéma des années 60 et 70 et
la création cinématographique actuelle.
| |
 |
|
|
Quand je discute avec eux, je m’aperçois
qu’ils attendent de moi un encouragement à continuer dans
la recherche de l’expression de la spiritualité par le cinéma ;
c’est quelque chose qui est en eux et que je vois déjà dans
les films qu’ils font. Mais ils sont très prisonniers d’une
culture dominante, d’un climat intellectuel hostile. Dans
les années 60 et 70, il y a eu un décalage entre les films
faits par des cinéastes ayant une ou deux générations de plus
et les soixante-huitards qui étaient les spectateurs mais
pas les créateurs de ce cinéma, et qui avaient une culture
très intolérante, avec des certitudes absolues. Comme les
soixante-huitards ont toujours le pouvoir et qu’il y a un
héritage intellectuel de cette époque, il y a une sorte d’angoisse
chez ces cinéastes contemporains qui ont des aspirations spirituelles.
Et donc, parfois, j’ai l’impression d’être, d’une manière
presque passive, par ma simple présence, un passeur. En faisant
ce que je fais et en tenant le discours qui m’est naturel,
j’aide des gens à faire ce que, de toute façon, ils doivent
faire, et qu’ils feront…
Donc, par rapport à l’histoire du cinéma, je suis peut-être
une soucoupe volante partie du cinéma des années 70 et qui
arrive au début du vingt et unième siècle…
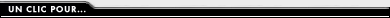 |
|
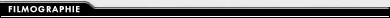 |
|
2001 Toutes
les nuits avec Alexis Loret, Adrien Michaux
2003 Le
Monde vivant avec Adrien Michaux, Alexis Loret
|
|