LE
CINEMA COMME « PERFORMANCE POETIQUE »
« Si le son accompagne l’image depuis que le cinéma
a quitté son apparent mutisme, il s’en est fait le plus souvent
l’humble serviteur », écrit Laurent Ghnassia pour
introduire sa programmation « Du son à l’image »,
un des cinq « Ecrans parallèles » proposés par le
14e Festival international du documentaire de Marseille.
A l’heure où l’essentiel de la production documentaire se
divise en France entre films informatifs visant à remplir
le cahier des charges pédagogique des chaînes de service public,
et tentatives psychothérapeutiques où l’auteur soigne un traumatisme
personnel par un film sans grand moyen ou talent, il nous
a semblé opportun de nous souvenir que le documentaire est
historiquement une tentative de parler du monde avec des images
et du son. Nous avons donc pris le parti de naviguer avec
Laurent Ghnassia sur les mers incertaines où ces deux médias
se brouillent, pariant que ces expériences audiovisuelles
originales pourraient renouveler notre disposition à écouter
et à voir. Sur ces mers, nous avons abordé onze îlots, courts
ou longs métrages constituant « autant d’approches
pour que, le temps d’une séance, vos oreilles conduisent vos
yeux ». Puis nous en avons parlé avec Laurent Ghnassia,
pour tenter de comprendre comment ce voyage nous avait transformé.
|
| |
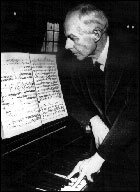 |
|
|
Objectif Cinéma :
Pour aborder cette exploration,
on pourrait partir du film Image cinématographique de Bartok
(1989), de Peter Sulyi, où des pianistes professionnels essaient
de reconstituer la musique du compositeur à partir d’un film
muet le montrant à l’œuvre derrière l’instrument. Ce film
est peut-être l’œuvre matrice de ta programmation, parce que
les questions que s’y posent les interprètes portent non seulement
sur leur propre rapport à l’image, mais recoupent aussi celles
que tu poses dans ton texte introductif. Par exemple, à un
moment, la pianiste s’arrête de jouer. « Mais si vous
faites un film, dit-elle, il faut bien qu’il y ait
de la musique, et tout s’explique par cela : qu’il y
ait de la musique sans son ». Dans une autre scène,
on ne voit plus les mains de Bartok sur le clavier. A nouveau,
la pianiste réagit : « il serait honnête de ne
rien jouer ici, car nous ne savons pas ce que c’est ».
Outre le fait qu’une telle remarque dénote une absence de
recul par rapport à ce qu’elle fait – même si elle arrive
à reproduire fidèlement les notes que joue Bartok, l’honnêteté
ne sera jamais complète parce que c’est elle qui joue aujourd’hui
et non Bartok il y a cinquante ans -, elle induit aussi
un rapport de fidélité, de subordination, que le son devrait
à l’image dans un film. Est-ce pour remettre en cause ce rapport
usuel de hiérarchie du son à l’image que tu as fait cette
programmation ?
Laurent Ghnassia : Oui,
dans une certaine mesure. Toutefois, j’ai également écrit
que l’objet n’est pas forcément de « restituer ses
lettres de noblesse » au son, « mais d’explorer
plutôt le formidable champ qu’il occupe lorsque l’image se
propose de mettre en scène sa puissance évocatoire ».
Dans le film sur Bartok, ce qui m’a fondamentalement ému,
c’est la puissance sonore contenue dans une image muette enregistrée
dans les années 1940 et que des musiciens, quarante ans après,
essaient de matérialiser. Se posent alors des problèmes de
vitesse, puisque la pianiste s’aperçoit qu’il est impossible
de jouer le morceau aussi vite qu’elle l’entend à l’image,
même si celle-ci est muette. Un autre moment fort, c’est quand
les mains de Bartok n’apparaissent plus à l’écran, et c’est
alors la position du corps qui dicte le son. Au-delà des seules
mains sur le clavier, aisément retranscriptibles pour les
pianistes, il leur faut à un moment retrouver la partition
à partir d’un seul mouvement d’épaules, d’un regard, d’une
position du cou ou des yeux. Et je trouve qu’il y a une très
forte poésie dans ce film à cause de ça.
Cette force-là du son contenue dans l’image muette, on la
retrouve également dans The Garden path, le film que
Mary Beth Reed a consacré à Stan Brakhage en 2001. Les films
sur Bartok et sur Brakhage sont des films dont le son est
contenu dans l’image et qui n’ont pas besoin de matérialisation
sonore immédiate : l’imaginaire peut le faire et, dans
le cas de Bartok, deux musiciens se chargent de le faire pour
nous.
|