 |
|
|
|
Objectif Cinéma :
Peut-on creuser cette idée
de « son contenu dans l’image » ? Pourquoi,
selon toi, le mutisme du cinéma muet n’est-il qu’« apparent » ?
Laurent Ghnassia : Dans
l’ensemble du cinéma muet, je crois qu’il existait tout de
même un son mental. L’image produisait en soi le sens sonore.
Et ce phénomène s’est atténué avec l’apparition des moyens
d’enregistrement du son : le son a fixé l’imagination,
il l’a canalisée vers un endroit précis.
A un moment, dans cette programmation, j’ai réfléchi à partir
de documentaires sonores, avec uniquement des sons dans une
salle noire, qui auraient initié un processus complètement
inverse où le son produit des images mentales. J’avais trouvé
une pièce sonore de deux artistes sur un musicien. Ca n’avait
rien à voir avec un travail radio, c’était un objet qui engendrait
l’apparition d’une image mentale, et aussi d’une troisième
dimension spatiale qui n’existe pas dans le cinéma. Car cette
pièce est spatialisée. On ne peut guère la comparer au cinéma
ou à la radio, dont le dispositif stéréophonique est plaqué,
à deux dimensions uniquement. Là, on est sur 4, 8 ou 16 pistes,
qui se matérialisent chacune dans un endroit de l’espace.
C’est aussi ça, la puissance du son.
Objectif Cinéma : Tu
parles du pouvoir d’évocation de l’image. Moi, j’ai plutôt
été frappé par le pouvoir d’évocation du son. A la fin de
Viola sonata, Dimitri Chostakovitch (1981) d’Alexandre
Sokourov, on entend Chostakovitch au téléphone, il chantonne
sa sonate : « Tadatadatadada ». Et ensuite
seulement, on entend ces quelques mesures effectivement jouées
par un orchestre. A ce moment, j’ai eu l’impression que toute
la musique symphonique, tout ce déploiement instrumental était
déjà contenu en puissance dans la seule voix de Chostakovitch
qui grésillait quelques secondes auparavant.
Au début du film, Sokourov retrace le début de la carrière
de Chostakovitch, quand il improvisait au piano pour accompagner
des séances de cinéma muet. Chostakovitch commente. « Ce
travail d’illustration mécanique des passions humaines m’a
tellement fatigué. Par la suite, je me suis promis de faire
de la musique vraiment et de m’y consacrer totalement ».
Pour Chostakovitch, la musique doit donc prendre son autonomie,
elle ne peut pas rester dans un rapport de seule illustration
par rapport à l’image. Toi, dans ta programmation, tu remets
également en question ce rapport et tu proposes au contraire
des films qui viennent illustrer la question du son et de
la musique, qui parlent de musiciens : Chostakovitch,
les Rolling Stones, Kevin Coyne, Daniel Johnston...
| |
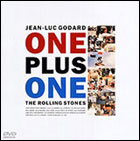 |
|
|
Laurent Ghnassia :
Je ne suis pas tout à fait d’accord.
Dans One plus one (1968), Jean-Luc Godard s’intéresse
effectivement aux Stones, à des musiciens. Dans The Garden
path, Mary Beth Reed parle également d’un musicien, Brakhage,
qui pour moi est un musicien de l’image. Par contre, le film
de Sokourov ne peut pas se réduire à la mise en scène de l’œuvre
d’un musicien. Ce qui m’intéresse fondamentalement dans ce
film, c’est plutôt la bande son imposée : la dernière
sonate de Chostakovitch, sur laquelle est plaquée, racontée
une histoire en images, avec une emphase dramaturgique de
la musique grâce à ces images. Ainsi la silhouette de Leonard
Bernstein, lorsqu’il dirige, semble animée, presque comme
une marionnette, par cette sonate. A l’inverse, Evgueny Mravinsky
dégage une telle autorité qu’on a l’impression qu’il maîtrise
la musique, qu’il la génère, et à ce moment-là l’image reprend
le pas sur le son.
Dans un passage du film qui m’a beaucoup marqué, on voit une
femme haranguer les foules en disant que le peuple soviétique
vaincra l’Allemagne, et que tout le monde doit se mobiliser.
A ce moment-là, il y a une puissance du son qui est corroborée,
amplifiée par les propos de la personne que l’on voit à l’écran.
Et aussi par le côté saccadé du montage. Au-delà du récit
de la vie de Chostakovitch, qui est un peu le fil rouge, ce
film raconte surtout une partie de l’histoire de l’URSS. Dans
cette narration, la base principale est la musique, et les
images racontent cette histoire en naviguant au gré de la
dramaturgie de la sonate.
|