Nadia
Meflah : Etes-vous rentré
en contact avec eux pour en parler ?
Gillo Pontecorvo : Non.
Ca ne m’intéresse pas.
| |
 |
|
|
Mathilde Marx :
Vous avez tourné un documentaire à Alger en 1992. Pourquoi
ce retour ?
Gillo Pontecorvo : C’est
la télévision qui voulait faire 34 minutes sur le voyage de
quelqu’un qui avait été le réalisateur d’un autre film dans
une toute autre situation. C’est mon fils qui a pratiquement
tourné, j’ai simplement fait l’acteur. Je marchais, et mon,
fils qui était le directeur de la photo et le metteur en scène
a tourné le film.
Nadia Meflah : Quel
effet cela vous a-t-il fait ?
Gillo Pontecorvo : J’étais
vraiment très triste, car à l’époque où l’on a fait le tournage [de
la bataille d’Alger], il y avait une vivacité et un
espoir qui imprégnaient tous les rapports humains. Tandis
que là, les choses n’avaient pas marché comme on l’avait voulu,
c’était un climat beaucoup moins joyeux. Et puis, il a trois
ans, j’étais à Alger avec ma femme pour une projection spéciale
de Retour à Alger. Ma femme connaissait très
bien l’Algérie de l’époque et elle voulait la revoir. (Intervention
en italien de sa femme). Elle dit qu’à l’époque où on
a tourné, on avait bénéficié d’une solidarité énorme :
tout le monde nous aidait, Saadi Yacef qui connaît la Casbah
comme ses mains a trouvé toutes les personnes justes.
D’ailleurs, il était un coproducteur exemplaire parce qu’extrêmement
discret. Une fois seulement, il a demandé qu’on change une
scène : c’est une petite fille qui lèche une glace juste
avant qu’une jeune Algérienne pose une bombe. Moi, j’ai dit :
« Je ne l’enlève pas, après tu comprendras que c’était
juste pour vous. » Et en effet, quand le film est
sorti à Venise, la critique fondamentale, c’était l’honnêteté.
Donc, cette scène a certainement joué en faveur d’une honnêteté
intellectuelle. Et au fond, c’est la vérité : on met
une bombe, il y a un enfant, c’est…la déveine. Ça donnait
la sensation qu’on n’avait vraiment pas choisi un côté ou
l’autre.
Nadia Meflah : D’ailleurs
vous faites un portrait tout en nuance du général, interprété
par Jean Martin.
Gillo Pontecorvo : Non
seulement ça, mais si vous remarquez, la musique sur les morts
algériens et sur les morts français est identique. Parce que
c’est la guerre.
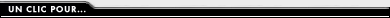 |
|
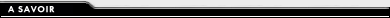 |
|
Gilberto Pontecorvo, dit Gillo
Pontecorvo naît à Pise en 1919. Pendant
la seconde guerre mondiale, tout en suivant des
études de chimie, il travaille comme journaliste
et messager pour le parti communiste italien.
Il participe à un réseau de partisans antifascistes
et prend pour nom de guerre Barnaba. Une fois
la paix signée, il devient correspondant à Paris
de plusieurs journaux italiens. C’est alors qu’il
voit le film Paisa de Rossellini et, aussitôt,
abandonne son métier de journaliste, achète une
caméra et commence à tourner des courts-métrages
documentaires.
En 1956, Giovanna relate la grève des femmes
dans une usine de tissus. L’année suivante, il
tourne son premier long-métrage, La Grande
route bleue (La grande strada azzura),
aussi exploité sous le titre Un dénommé Squarcio.
Cette adaptation d’une nouvelle de Franco Solinas,
qui deviendra son scénariste de prédilection,
décrit la vie difficile d’un petit village de
pêcheurs.
En 1959, Kapo narre l’histoire d’une jeune
fille juive, internée dans un camp de concentration,
et qui devient l’auxiliaire des officiers nazis.
Le projet suivant du cinéaste connaît plus d’aléas.
Gillo Pontecorvo songe très vite à un long-métrage
sur la guerre d’Algérie. Mais celui-ci ne voit
le jour que trois ans après la fin des hostilités,
lorsque Saadi Yacef, ancien commandant des troupes
algériennes, devenu président de Casbah Films,
lui propose l’idée d’un film basé sur ses propres
souvenirs de combat. Ce sera La Bataille d’Alger
(La battaglia di Algeri), en 1965. En 1971,
Queimada est de nouveau un regard sur le
colonialisme, cette fois dans les Antilles du
XIXème siècle, interprété par Marlon Brando. En
1979, Ogro traite du terrorisme, à travers
le meurtre du successeur du général Franco, et
de la fin d’une dictature.
|
|
|