" Si Max Ophuls est l'un des plus grands cinéastes
qui soient, si ses films peuvent inspirer une telle pluralité
de lectures, c'est d'abord parce qu'ils mettent en œuvre
ce dialogue ininterrompu avec la mort qui est au cœur
du cinéma. " Noël Herpe.
D'emblée, l'œil analytique
s'ouvre en éventail, et tend vers une " pluralité
de lectures ". D'emblée surtout, la richesse
infinie de l'œuvre est mise en exergue, comme le dépliement
d'une exégèse qui porte sur " une
figure fascinante et encombrante ", selon l'expression
juste de Noël Herpe. Max Ophuls (son œuvre, son
statut) fait désordre : 1895 ne le récuse
jamais, et s'efforce au contraire de clarifier ce qui parut
aux yeux de la critique comme un art impur, dans sa " négation
explicite des limites de l'espace-temps ". Une
œuvre incomprise que la revue restitue ici, de " plans
d'ensemble " en " plans rapprochés ",
en 455 pages. Une somme d'articles et travaux pour désherber
l'invisibilité née autour de l'œuvre.
Dans le premier plan d'ensemble
sur la poétique de Max Ophuls, Barthélémy
Amengual apporte un premier indice précisant le malaise
général autour de l'œuvre. Ce qui indique
déjà la volonté de tabula rasa qui
anime secrètement ce numéro de 1895 :
" Synthèse, équilibre et entre-deux :
cette absence de lieu, le mouvement constant d'un extrême
à l'autre, de l'image et de l'imagination, sont également
caractéristiques de l'état de flottement esthétique
auquel Ophuls s'abandonne et qu'il fera sien à l'écran. "
Flottement artistique : incompréhension critique
et publique. Ce public au cours de l'année 1954 (le
scandale Lola Montés) qui fut, comme la critique,
intransigeant. De cette année-là ont fleuri
une kyrielle de malentendus qui ont rangé Ophuls
l'inclassable en cinéaste baroque.
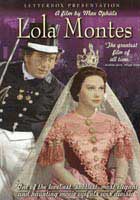 |
|
|
|
Baroque : un épithète
maudit que lui-même récusait, et dont Barthélémy
Amengual réinvestit le sens premier, en définissant
le baroque " par sa quête du mouvement,
plus ou moins exaspérée ; son amour du
masque et de l'apparence ". Art du trompe-l'œil
et du mirage : il est donc certain qu'Ophuls " chérissait
les miroirs, persuadé que la réalité
est moins belle que son reflet. " Selon Amengual,
le pessimisme profond du cinéaste, en premier lieu,
scande sans doute le baroquisme du cinéaste. Une
œuvre qui alterne autant " pessimisme averti "
(selon l'expression de Claude Beylie) et exubérance
désenchanté naît baroque, dans
la jonction de deux courants baroques ; le premier
étant " inquiétant, angoissant,
funèbre " quand le second fut " clair,
léger, lumineux, festif ". Réminiscence
des visions de ses films : le plaisir gît ici
(la quête de Madame de… ne s'épuise-t-elle
pas dans son " pessimisme averti " ?)
et là (quiétude et gravité des valses
dans le même film), dans l'écartèlement
des courants, le délitement des formes. Un même
plaisir qui se dilate dans la mise à plat analytique.
On revient à une infrastructure du Plaisir
(du cinéaste, du spectateur), né du " romantisme
sobre " (Noël Herpe) d'une Vienne fin de
siècle, qui était " un état
d'esprit, une forme de sensibilité " (Amengual).
Pourquoi " filmer comme on se souvient " ?
Simplement parce que sa Vienne heureuse s'éloigne
et se meure. La poétique d'Ophuls, si elle souhaite
" édifier des obstacles et aussitôt
les abolir " (Amengual), ne s'attache qu'à
préparer la mort, telle une cathédrale qui
ornerait un passé perdu et ressuscité.