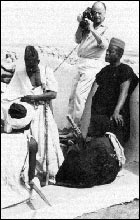 |
|
|
|
Car, à lire le
texte " futur antérieur "
de Jean Narboni (où le titre me fait songer à
La Jetée de Marker…), enfin il est possible
de nommer d’historicité " sans refoulement
actif " " un geste impatient et juvénile
de liberté " un temps du cinéma où
l’on ne savait pas trop comment dire cette émergence :
nouvelle, jeune, vague ; trois mots à la fois
fourre-tout et en même temps héritiers de leur
grand frère La Nouvelle Vague Française… Mais
l’auteur règle aussi ses comptes politiques avec les
dits historiens du cinéma, professionnels haineux avec
une " aversion pour ces années qui les
ont vus surgir et au soulagement d’en être à
jamais sorti " et écorche au passage
le journaliste critique Jean-Michel Frodon, coupable de moralisme
d’un quant à soi assez distant et, in fine, de légèreté
douteuse venant d’un spécialiste du cinéma.
La colère, stimulante, met les pendules à l’heure
et rappelle combien ce cinéma taxé de " brouillon,
prétentieux, d’offense au récit, de laisser-aller
plastique, d’immaturité politique et de mépris
du spectateur " eut à subir d’anathèmes
irrationnels, signe d’un aveuglement crasse. Oui, mais voilà
que ce courant moins politique qu’existentiel devient à
son tour, par la grâce de l’embaumement commémoratif,
le lieu de la nostalgie d’un temps jadis honni et/ou méprisé.
Le rappel de ces réceptions diverses rend compte des
enjeux idéologiques et culturels que ces " jeunes
cinémas " interpellaient. Il s’agissait d’expérimenter
tout ce que peut le cinéma (son, image, parole, enregistrement
direct, intervention sur la pellicule, montage accéléré,
plan fixe de huit heures et plus etc.…) Tout devenait politique,
le structuralisme et la pensée sartrienne envahissaient
les écrans, les radicalités s’affichaient en
toute beauté et les querelles faisaient rage. Belle
époque où la contestation prenait corps et rue
(Mai 68…). Gérard Leblanc raconte une expérience
de ce cinéma vécu comme " opérateur
critique de la représentation " avec pour
enjeu premier de bouleverser la place du spectateur. Il s’agissait
vraiment d’une éducation du regard, ce à quoi
s’attachait la revue Cinéthique qu’il dirigeait (fondée
en 1969, il en a assuré la rédaction jusqu’en
1985) avec cette utopie de vouloir transformer le réel.
Le cinéma avait le devoir d’agir sur le spectateur
citoyen, non en le divertissant (aliénation mercantile
du film comme objet de consommation) mais en lui faisant prendre
conscience des conditions de travail mise en œuvre à
l’intérieur même de la machine cinéma.
Voire d’élaborer une " théorie
de la valeur au cinéma, sur la base de la théorie
marxiste de la plus-value (…) la valeur d’usage des films
ne devait plus être régie par la valeur d’échange
évasion. " Quant à Jean-Louis
Comolli, il nous interpelle en questionnant la place et la
parole des cinéastes de cette époque :
qui filme ? au nom de quoi et d’où ? L’énoncé
et l’énonciateur sont affaires de point de vue où
la pratique, " une expérience, une construction,
une lutte, une transformation du sujet et de la cause elle-même
par l’action " engageait chacun dans un ici et
maintenant. Alors foin du très vieux faux débat
sur l’objectivité et la subjectivité (je renvoie
le lecteur taraudé par cette vieille antienne au court
texte clair et concis de Roland Barthes "Critique et vérité",
à la page 17 notamment, aux éditions Points
essais) quand il s’agissait avant tout d’énoncer un
acte, d’élaborer une parole et de tracer des chemins
de découverte. Un film revient lancinant, Moi, un
noir de Jean Rouch. Film-jazz chez l’historien du cinéma
Gilles Mouëllic (lire à ce sujet l’entretien autour
de son ouvrage Jazz et Cinéma paru en 2000) il est
" toujours le futur de tous les actes qui l’ont
fait. Tout est déjà là, rien n’est encore
advenu. Invraisemblable vérité du temps cinématographique. "
Ces mots vibrants ; le reste du texte transmet le souffle
comollien, et nous parviennent alors même que nous ne
pouvons plus voir certains des films décrits. Si ce
n’est dans le cadre (encadré…) d’une rétrospective
(hommage aux morts…)
Rêvons un peu de ces
films disséminés dans les rues, sur les murs
fouettant de leurs alarmes glorieuses nos si pathétiques
vies publicitaires.
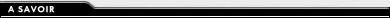 |
|
Le livre propose une filmographie sélective
commentée avec concision des films, tous
programmés dans le cadre de la rétrospective
Cinéma et Politique de la B.P.I Centre
Pompidou ainsi qu’un choix judicieux de photographies
en noir et blanc de certains films cités.
Une brève biographie présente chaque
auteur dans son travail passé et présent.
Gérard
Leblanc est professeur à Paris III Censier
Sorbonne Nouvelle et à l’Ecole Louis Lumière,
spécialiste émérite et éclairé
des genres télévisuels, il a, notamment,
édité un splendide ouvrage de et
avec Jean Daniel Pollet "L’Entre Vues" aux éditions
de L’œil en 1998.
Jean-Louis
Comolli et Jean Narboni ont en commun d’avoir
été rédacteurs en chef des
Cahiers du Cinéma entre 1962 et
1972. J. Narboni est professeur à Paris
VIII université de Saint-Denis et à
la FEMIS, quant à J.L Comolli , il est
surtout connu du grand public pour son travail
documentaire sur Marseille (Les deux Marseilles
en 1968, Marseille en Mars en 1993,
Marseille contre Marseille en 1995, lire
à ce sujet la très belle revue en
cinéma de Patrice Leboutte L’Image,
le monde, dont le deuxième numéro
est sorti à l'automne 2001.
|
|
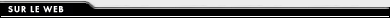 |
|
Titre : Cinéma et politique : 1956-1970
les années Pop
Auteurs : Jean-Louis
Comolli, Gérard Leblanc, Jean Narboni
Type : catalogue d'exposition
(broché)
Editeur : Bpi Du
Centre Pompidou
Nombre de pages :
132 pages
Format : 16 cm
x 22 cm
Illustration :
Photos noir et blanc
|
|
|