La dernière parution
de Trafic, excellente, établit un nouveau travail
de considération. On pourrait se suffire à résumer
ce numéro de la sorte, à travers les deux ensembles
de textes consacrés à deux cinéastes
passionnants : l’un, Harun Farocki, plongé dans
l’actualité à l’occasion de la rétrospective
proposée judicieusement par La Cinémathèque
Française ; l’autre, Jerzy Skolimowski, hors actualité,
dont l’aura poétique, intellectuelle, ne cesse de prendre
de l’ampleur critique ces derniers temps.
| |
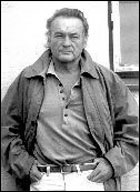 |
|
|
La force de Trafic,
modeste et illimitée : ici, on consacre autant
qu’on exhume. Le cinéma free-jazz de Skolimowski (très
beau texte, " Entre ciel et terre ", de
Jean Durançon) est resté longtemps méconnu
avant que la Cinémathèque française,
encore, ne lui consacre une rétrospective en décembre
2001. Exhumation totale : ahuri, on découvre,
rétrospectivement, un pan inconnu de l’œuvre de Skolimowski,
la poésie. Une propension surréaliste (datant
de 1973) qui fascine et évoque une partie de l’avant-garde
américaine (le cinéma de transe, Maya Deren)
jusqu’à préfigurer le mythique Outer Space
de Peter Tscherkassky, dans le sublime " Meurtre
en douceur " : " Veuillez ne pas
régler mon visage. Le défaut est en moi ".
Dans les plus beaux manifestes,
officiels ou plus secrets, des Nouvelles Vagues mondiales
(des Innocents charmeurs d’Andrej Wadja et Skolimowski
au scénario, aux Bonnes femmes de Chabrol),
domine un souffle commun. Ce qu’explique aussi le texte richement
analytique de Marcos Uzal, intitulé " Une
adolescence éternelle ", qui ballade le lecteur
dans les villes-panoramas de Rysopis et Walkover :
dans ces films, une même secousse langoureuse, divine,
se produit et renverse l’idée de théâtralité,
de représentation, d’ellipse, portant le direct dans
ses limites mêmes. Le cinéma de Skolimowski vante
une rythmique double, muette et légère, sourde
et funambule (Le Départ), sombre et chromatique
(Deep end), tout en renouvelant, dans un élan
de liberté, la forme de la ville au cinéma.
En moulant et fondant l’espace urbain, en le diluant dans
le plan-séquence, de sorte que la nuit incarne un songe,
une ville, le songe d’une ville (dans Profondo rosso,
Dario Argento ira jusqu’à bloquer la profondeur de
la ville en vitrifiant les façades), un non-lieu aussi
ludique que labyrinthique. L’homme et la ville se regardent
et se parlent, disent le même libre cours, grand inachèvement comme
métaphore de l’enfance : " Le monde y est
perçu comme un immense chantier où tout est
en construction, en suspens. " (p. 84). Et à
travers les coutures de la ville (nulle impasse, que des passages),
règne de la déambulation, à travers détours
nocturnes, longs raccourcis, carrefours déserts (Antonioni,
dans L’Éclipse, y concocte un rendez-vous manqué),
l’un verse, peu à peu, dans l’autre, comme dans un
progressif sommeil, jusqu’à une propension mimétique
dans un seul étirement (la rue comme arcane mentale
et musicale).
 |
|
|
|
Trois textes, dont un de
Farocki lui-même, composent l’ensemble sur le cinéaste
allemand. Le plus riche, " Harun Farocki, l’art
du possible " de Christa Blümlinger, pose une
réflexion sur les installations vidéos de l’auteur,
en particulier Auge / Maschine (Œil / Machine,
2001) et I thaught I was seeing convicts, que le Goethe
Institut a parallèlement exposé. La projection
sur deux écrans se poursuit ici par une analyse théorique
de cet " agencement double ", étude
du couple que forme l’image analogique et l’image numérique.
Éloge et relecture critique du cinéaste :
Christa Blümlinger dévoile brillamment dans son
texte " l’architecture visuelle de Farocki [qui]
déploie une structure complexe où se mêlent
le digital et l’analogique, le simultané et le consécutif,
le dicible et le visible. " Cet élan revêt
les traits aujourd’hui d’une critique qui s’y consacre, presque
seule, depuis longtemps et, à cette occasion, publie
parallèlement (avec des écrits de Farocki)
Reconnaître et poursuivre, aux éditions THTY.
|