| |
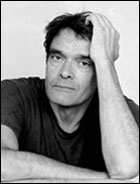 |
|
|
Déjà, la conférence
qui inaugurait les installations au Goethe Institut laissait
entrevoir des pistes critiques foisonnantes. La visée :
mettre en saillie tous les croisements souterrains du cinéma-dispositif
de Farocki, entre l’installation vidéo et la pratique
du found-footage, entre le film et l’art contemporain.
Entrons dans l’image de l’un de ses films, Auge / Maschine,
au cœur des richesses plastiques et politiques de Farocki.
Le cinéaste ébauche ici une réflexion
sur l’usage des images de la Guerre du Golfe comme nouvelle
propagande, certaines télévisions menant la
guerre par des moyens électroniques. Il en va ainsi
de la caméra-suicide, vue subjective d’un zoom foudroyant
qui tombe à terre. Mais ici, l’horreur de la prise
de vue qui mime une chute kamikaze est amplifiée par
la coupe de l’image au moment de l’impact à terre.
L’imaginaire ne travaille plus, seul l’œil humain se remet
de la chute. À quoi s’en remettre, sinon à un
facile et prudent non-sens, que signifie le nom de ce procédé
(et qui témoigne de son abstraction) : la caméra-suicide ?
La chute sans atterrissage confère un supplément
de stupeur en même temps qu’un gain de réel :
ne pas montrer les éclats du missile décuple
l’horreur. Redouble, au fond, l’effet de réel de la
prise de vue. Que des télévisions s’emparent
de ces images (ce qui pourrait expliquer sans doute la décision
de couper la dernière vue, l’image qui tue) dépasse
l’entendement et pose d’autres questions édifiantes,
du point de vue théorique, pratique et (dé)ontologique.
D’où proviennent exactement ces images qui vantent
le chaos et la destruction par l’image ? Qui fournit ces caméras
- suicides ? Comment et dans quelle visée prétendre
à un autre usage ? Nulle prise de vue humaine,
ici, ni de moments volés de guerre. Œil / Machine
ne constitue pas seulement un jalon sur l’image
de guerre mondiale. Comme le prétend le titre, le film
invoque la future désintégration de l’œil, son
ablation terminale au profit des machines de guerre et de
surveillance. Plus que jamais, comme le dit Christa Blümlinger,
dans Trafic, " l’ère industrielle
a remplacé le travail manuel par le travail des machines. "
Ce qui passionne réside
également dans l’étude de Farocki sur " l’évolution
de la technologie de surveillance ", à l’œuvre
dans I thought I was seing convicts. Dans une vision
et une pratique du chaos, véritable utopie de surveillance
(dépassement total de l’ubiquité du Panopticon,
que Foucault décrypte dans Surveiller et punir),
la nouvelle ère de l’image de surveillance abolit l’être
humain au profit de l’œil-caméra. Dans un couloir de
prison ou dans l’œil du missile œuvre une seule machine.
Le but : se libérer d’une ancienne méthode.
Christa Blümlinger achève d’expliquer la disparition
du témoignage de l’œil (la fabuleuse prémonition
des Mille yeux du Docteur Mabuse de Fritz Lang paraît,
ici, furieusement datée), en analysant ces " micro-fonctions
du pouvoir dans les sociétés disciplinaires. "
L’analyste démontre enfin que Farocki travaille, en
outre, la retranscription des images, la mémoire des
images technologiques. Est créé un œil anthropomorphique,
par un savant jeu de lignes, rouges, vertes, qui dessinent
la reconnaissance d’un chemin, des appareils (avion à
l’atterrissage) en mémoire. Il s’agit donc d’une mise
à nu de la robotique. " Ainsi ne voyons-nous
pas seulement des détenus filmés par une caméra
vidéo, mais aussi la transposition graphique qu’en
donnent les détecteurs de mouvement électronique. "
 |
|
|
|
Il faut lire notamment cet
ensemble de textes sur Harun Farocki qui dresse, grâce
à l’analyse limpide de ses films, les nombreux et nouveaux
statuts du cinéaste : historien des technologies
et historien de l’image technique, et ce par l’archive des
images ; ce qui augure à la fois d’une histoire
d’un certain pan du found-footage ainsi qu’une histoire
des dispositifs. C. Blümlinger lors de la conférence :
" ne plus filmer avec un effet zoom, ni filmer des
blocs de maison (cinéma narratif) : trouver un
nouveau point de vue en filmant des images de l’Univers. "
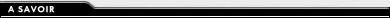 |
|
Le sommaire du numéro 43 de Traffic :
Le cinéma est une
invention post-mortem par Erik Bullot
Influences transversales par Harun Farocki
Travailler avec Harun par Hanns Zischler
Harun Farocki : l'art du possible par Christa
Blümlinger
Six Feet Under, croque la mort par Emmanuel
Burdeau
Le navire aux huit voiles (et aux cinquante
canons noirs) par Z. Lund
Abel Ferrara versus XXe siècle : une
Passion critique par N. Brenez
Lettre de Melbourne par Adrian Martin
Meurtre en douceur par Jerzy Skolimowski
Skolimowski entre ciel et terre par Jean
Durançon
L'adolescence éternelle par Marcos
Uzal
Un cas de refoulement dans l'espace par
Jean-Claude Pons
Le dépli des émotions par
Raymond Bellour
Dante Schelling Godard / Histoire(s) (montage)
par Helmut Färber
|
|
|