PASCAL ESTEVE - PATRICE LECONTE
Etude d’une co-habitation musicale
Un soir, deux hommes que
tout sépare se rencontrent par hasard dans une petite
ville du centre de la France. L’un (Milan, Johnny Halliday)
prépare en secret le hold-up d’une banque, l’autre
(Manesquier, Jean Rochefort), vit pianissimo une retraite
confortable. Les choix visuels de Patrice Leconte s’affichent
immédiatement : il éclaire le baroudeur Milan
dans des tons bleutés, " métalliques ",
et Manesquier dans des teintes feutrées, " tabac.
"
| |
 |
|
|
Musicalement, Pascal Estève
(qui travaille ici pour la troisième fois avec Leconte)
évoque aussi à sa manière l’opposition
des styles : d’un côté, une guitare sèche
aux accents westerniens (Milan a la dégaine d’un cow-boy)
et de l’autre, un piano parsemé de notes de Schubert
(Manesquier joue un soir l’Impromptu en La bémol de
Schubert).
Leconte raconte: " Notre idée était
simple : trouver une couleur musicale précise pour
chacun des deux personnages, et mélanger ces couleurs,
au gré des scènes, même si, a priori,
rien ne laissait prévoir quelles puissent se mélanger.
Ainsi, la musique de L’homme du train, c’est la rencontre
inattendue de Ry Cooder et de Schubert, aussi improbable que
la rencontre de Johnny Halliday et Jean Rochefort. "
(cf. livret du CD)
L’homme du train est donc a priori le film d’une très
nette opposition ; un choc des mondes et un choc de monstres
sacrés. Quelques accrocs d’abord, quelques syncopes
et dissonances de style. Puis, il fallait s’y attendre, la
rencontre des deux hommes se transfigure peu à peu
en amitié et deux rythmes de (dé)marche évoluent
alors à l’unisson.
L’affiche du film annonce d’ailleurs ce monstre à deux
têtes ; tous les deux portent la moustache, cheveux
courts, et un regard braqué, perdu, vers une même
obscurité. Il ne s’agit donc pas tant dans L’homme
du train d’un " face à face " ni d’un
" duel ", mais, d’abord, d’un métissage,
voire d’un transfert de personnalité.
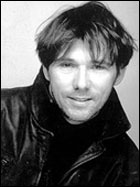 |
|
|
|
Si le script semble préférer
l’hypothèse d’un transfert de personnalité (Halliday
réclame des pantoufles et Rochefort apprend à
tirer au revolver), la musique penche davantage vers une idée
de brassage stylistique. Il n’y a pas réellement de
renversement, mais un vrai mélange, une co-habitation
de sonorités, avec ces deux personnages habitant sous
le même toit.
Là se joue la vraie subtilité et ambiguïté
du faux face à face. Estève nuance la relation
en brouillant les pistes. Le compositeur mêle à
sa partition elle-même des sons extra-musicaux, le compositeur
devenant designer sonore du film (plage 1). N’est-ce pas ce
que devrait être aussi un compositeur de cinéma
? Habillant, ou embaumant, les personnages et les lieux.
C’est une manière en tout cas de maîtriser les
effets sonores faisant souvent tort à la musique de
film aujourd’hui. Ainsi, jaillissent le son d’une horloge
et le balancement mécanique d’un train en marche. Ces
deux sons métalliques d’un train-train (de la mort
?) en marche se rejoignent et sont peut-être les moteurs,
et anges de la mort, des deux protagonistes.
" J’ai construit cette musique sur l’idée du
temps et du voyage ", écrit Estève,
" avec ce que Milan et Manesquier trimbalent avec
eux ; un jardin secret." (cf. livret CD). Une partition
camouflant donc à peine un double requiem (plage 5).
On voit dans le film Milan disparaître comme un fantôme
dans un fondu enchaîné, tout comme Manesquier,
stagnant presque " momifié " dans une maison-musée.
|