| |
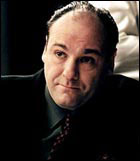 |
|
|
Avec le temps comme seule
arme, Chase a pu créer un personnage de gangster qui échappe
aux stéréotypes monolithiques du type : le teigneux (les rôles
tenus par Joe Pesci), le « beauf » parvenu (le Scarface
de Stone) ou le Prince noir flamboyant (Pacino encore, mais
dans Le Parrain). Tony Soprano, lui, dévoile au moins
un aspect de sa complexe personnalité par scène : il est la
somme de ses glorieux aînés mais vaut bien plus qu’eux tous
réunis. Il est à la fois fils et père, paternel et materné
(par sa psy qui « voit l’enfant qui est en lui »),
mari et amant, manipulateur et manipulé, raciste et victime
du racisme, toujours en bande mais définitivement seul. Tour
à tour effrayant (dans ses accès de violence rageuse), pathétique
(dans sa dépression) ou réellement émouvant, l’acteur principal,
James Gandolfini - comme le reste du casting - réussit le
tour de force de toujours rester en équilibre sur la crête
qui sépare le versant dramatique du registre purement comique.
Mais, ici, le rire n’est pas libérateur, l’humour des scénaristes
est parfaitement noir. Le comique ne vient pas contrebalancer
une vision trop pessimiste; au contraire, le grotesque -
des corps, des fringues, de l’inculture crasse de tout ce
petit monde - renforce le caractère troublant et inquiétant
de la série.
Il faut dire que le rapport qu’a Chase avec ses personnages
est pour le moins ambivalent. À ce propos, James Gandolfini
parle de “self-loathing”, c’est-à-dire, littéralement, de
“mépris de soi”. Il explique: « I think he (David Chase)
can write it, I can play it, and Tony has it. » La beauté
et la vérité des personnages réside dans le rapport problématique
et souvent douloureux qu’ils ont avec leur identité communautaire
(et ses clichés dont ils sont les prisonniers semi-consentants),
c’est-à-dire avec la famille (ou la Famille): l’appartenance
à la communauté Italo-américaine les réconforte mais les isole
aussi du reste du monde. Comment faire pour qu’elle vous protège
sans vous étouffer? C’est la question que chacun se pose,
de Janice, la soeur de Tony (partie dans les années 70 en
Californie sous le nom (Indien ?!?) de Parvarti puis sagement
revenue dans le cocon du New-Jersey), à Meadow, la fille de
Tony, qui passe d’un petit ami Afro-Américain et Juif intello
(= l’Autre avec un grand A) à une histoire d’amour (finalement
sanglante) avec Jackie, son ami d’enfance, quasimment un cousin.
Cette question de l’individu dans ou hors de la communauté
d’origine (et surtout de ses codes de conduite) se pose sans
cesse dans Les Sopranos, et si elle est d’actualité
en France, où se produit un phénomène de repli des diverses
communautés sur elles-mêmes, elle est rien de moins que subversive
dans un pays aussi structurellement communautariste que les
Etats-Unis. « You’re born to this shit... You are what
you are. », crache le parrain dépressif à sa psy, pas
tant pour la persuader elle que pour s’en convaincre lui-même
et chasser le doute de son esprit.
 |
|
|
|
Si Les Sopranos fascinent
tant, c’est que, à bien des égards, c’est une œuvre vertigineuse.
Vertigineuse d’abord à cause des effets de mise en abîme qui
ponctuent les différents épisodes (Tony regardant le Scarface
de Hawks en DVD, Silvio singeant Pacino dans Le Parrain,
ou, plus subtil, Michael Imperioli - Christopher Moltisanti
à l’écran - tirant dans le pied d’un jeune pizzaiollo, rejouant
ainsi à l’envers la scène des Affranchis dans laquelle
Joe Pesci lui tirait dans le pied) et qui nous poussent à
imaginer que tous ces personnages sont des personnes qui vivent
dans le même monde que nous, maintenant .
Surtout, par un étrange phénomène de contamination, l’angoisse
existentielle de Tony se transmet lentement mais sûrement
à tous ceux qui l’entourent, de Pussy, personnage littéralement
rongé par le remords et le poids de sa trahison, à Davey,
le petit commerçant qui s’est endetté auprès des mafieux,
en passant par Makazian, l’inspecteur corrompu, et Christopher,
le gangster qui se brûle les ailes à Hollywood. Dans une très
belle scène, Tony et Christopher, deux grands dépressifs,
parlent du suicide comme d’une chose réservée aux losers et
font semblant d’en rire pour mieux cacher cette souffrance
indigne de vrais hommes.
Si ces caïds du New Jersey nous touchent, c’est qu’ils sont
bien plus proches de nous que tous les personnages plats et
figés qui peuplent l’essentiel du cinéma américain (même indépendant).
Comme Dorothy Vallens dans Blue Velvet, seuls des évènements
électrochocs empêchent Tony Soprano de sombrer dans une dépression
totale. Dans l’épisode intitulé Isabella (saison 1), alors
qu’il semble toucher le fond (avec les Tindersticks comme
bande-son!), le parrain retrouve un féroce appétit de vivre
en échappant in extremis à une tentative de meurtre... et
en tuant l’un des deux tueurs à gage. Comme nous tous, Tony
Soprano pourrait dire « vivre me tue » ; mais contrairement
à nous, il pourrait ajouter, tout en tirant d’hypnotiques
volutes de son cigare et en affichant un sourire carnassier,
que tuer le maintient en vie.
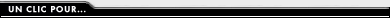 |
|
|
|