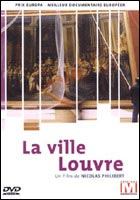 |
|
|
|
Cet entretien que l’on peut
découvrir suite à La ville Louvre conclut en quelque
sorte le coffret : les quatre films sont tour à tour
évoqués au long de 45 minutes que l’on trouverait presque
trop courtes. Philibert nous expose les hasards qui l’ont
conduit à la rencontre de ses sujets, sa méthode de travail
qui débouche sur une vraie philosophie du documentaire, et
plus encore, du cinéma. Car Philibert fait du cinéma. Comme
il l’explique, il n’illustre pas simplement une idée grâce
aux images. Et l’on ressent dans chacun de ses films un appel
des images. Chacune de ses œuvres est purement cinématographique :
ce qu’il montre ne pourrait être dit. C’est peut-être pour
cela que la parole paraît si peu présente. Lui n’intervient
en tout cas que rarement. Ou plutôt, la parole est directement
présente (particulièrement dans Le pays des sourds),
mais il y a peu d’entretiens entre le filmeur et le filmé.
Il s’instaure simplement entre eux un rapport de confiance
et de découverte, et il en résulte que le documentaire qui
nous est présenté fonctionne comme une fiction grâce au montage.
Le César qu’il reçut cette année pour Etre et Avoir
prend alors tout son sens.
Le besoin de filmer et de raconter se fait sentir, le désir
d’image est là : les tableaux et les statues du Louvre,
la pièce de théâtre des psychotiques, les animaux empaillés
du jardin des plantes, la langue des signes : quelle
langue peut être plus cinématographique que celle-ci ?
Philibert détourne chacun de ses sujets : des fous il
fait des amis, du Louvre un hôpital. Le grand Louvre dans
lequel chacun de nous s’est perdu, a marché pendant des heures
sans se demander si la Vénus de Milo était venue à cheval
ou en voiture, ou comment les toiles immenses de LeBrun, déployées
sur plusieurs mètres de hauteur et de longueur avaient pu
venir s’accrocher là. Loin des foules de spectateurs avides
de découverte et de redécouverte avec leurs appareils en bandoulière
(une photo saura-t-elle enfin briser le mystère du sourire
de la Joconde ?), Philibert filme un par un les différents
corps de métier et les 1200 employés qui peuplent le musée
tels des fantômes. Une autre vie se dévoile alors. Le cinéaste
prend le musée comme il retourne un tableau, joue avec l’endroit
et l’envers : l’œuvre vue et ce qui la porte, le cadre,
la toile, la matière.
| |
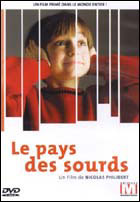 |
|
|
« Ce n’est pas un
film sur l’art » nous dit le réalisateur. Il pourrait
tout aussi bien dire « c’est un film sur l’artisanat ».
Car c’est bien le rapport avec la matière des œuvres et de
la structure qui les abrite qui l’intéresse. En témoignent
les gros plans sur les mains des conservateurs qui manipulent
avec attention les petits objets, sculptures, peintures, sur
les restaurateurs qui appliquent avec une délicatesse extrême
les feuilles d’or sur les cadres, quelques touches de peintures
sur les tableaux, qui vernissent, nettoient, époussettent
les œuvres. Et puis surtout les scènes sur les ouvriers chargés
de déplacer les œuvres, de les suspendre au mur, de les poser
sur les stèles, jusqu’à apposer les plaques descriptives à
l’attention des futurs visiteurs. Ces scènes ouvrières sont
peut-être les préférées de Philibert, c’est en tout cas ce
que l’on peut ressentir, entre tendresse et admiration. Car
le déplacement d’œuvres comme celles-ci nécessite une manipulation
à la fois douce et forte, précise et sûre : les ouvriers
déplacent les sculptures comme de grands malades, sanglés
et portés par un engin roulant. Combien sont-ils à soutenir
cette énorme toile de LeBrun, tous ensemble, guidés par une
voix ? Un plan sans doute mis en scène mais étonnamment
représentatif du travail de Philibert fait sortir de derrière
la toile posée contre le mur chaque ouvrier ayant participé
à son déplacement, un par un. Ce plan représente à la fois
la face cachée du Louvre et le foisonnement de cette fourmilière.
Et qui dit fourmilière dit labyrinthe, couloirs infinis. Philibert
les filme eux aussi, mais toujours en rapport avec la matière :
les pas d’une conservatrice à travers ces couloirs nous renvoient
l’écho du talon contre le marbre, le parquet, la moquette.
|