 |
|
|
|
Pendant les années de guerre et d’occupation,
les cinéastes ne font pratiquement pas référence aux événements.
Paris se criminalise (Le dernier des six, L’assassin
habite au 21) et se perd dans les rêves (cf le Paris onirique
de La nuit fantastique de L’Herbier). La tendance du
cinéma de studio s’accentue, Les Enfants du Paradis
se tournent aux studios de la Victorine entre 1943 et 1945
dans des décors imaginés par Alexandre Trauner. Comme le rappellent
les deux auteurs, ce film symbole des contradictions de l’époque
raconte autant « la perte de l’illusion que la pérennité
du spectacle ». Les années 50 voient la capitale s’incarner
dans de nombreux films policiers tournés en décors naturels
et des comédies musicales aux visions de cartes postales.
L’image de Paris au cinéma s’essouffle, vieillit, se ternit,
même si de grands cinéastes comme Ophuls offre des chefs d’œuvres
à la capitale (Le plaisir, Madame de…). A la
fin des années 50, des francs-tireurs en dehors de tous les
courants cinématographiques montrent un Paris dépoussiéré,
dans des décors naturels réinventés (Jean-Pierre Melville
et Bob le flambeur, Louis Malle et Ascenseur pour
l’échafaud), presque abstraits (Robert Bresson, Pickpocket)
ou jouant la carte du décalage en studio (Jacques Tati, Mon
oncle). Ils préparent le terrain de la Nouvelle Vague,
dont les cinéastes, ont, on le sait, contribué à re-dynamiser
autant le cinéma que l’image de Paris. C’est l’école buissonnière
de Truffaut dans Les 400 coups, les « turpitudes
parisiennes » de Chabrol (Les cousins, Les
bonnes femmes) la topographie intime des films d’Alain
Resnais (La guerre est finie), de Jean-Luc Godard (qui
descend encore les Champs Elysées sans penser à A bout
de souffle ?) d’Agnès Varda (Cléo de 5 à 7),
d’Eric Rohmer (on devrait lui consacrer un jour un livre sur
ses rapports avec Paris tant ils sont multiples), le Paris-jeu
de piste de Rivette (Paris nous appartient, etc) ou
le réel fantastique de Franju (Judex). Paris vu
par…reste d’ailleurs l’un des films emblèmes de ces rapports
entretenus par la nouvelle vague avec la capitale.
Binh et Garbaz consacrent également tout un chapitre au Paris
fantasmé par les Américains. Hollywood adore Paris, en studio
comme en décors naturels, et Lubitsch, Wilder, Blake Edwards
y ont tourné de savoureuses comédies, sans parler des musicals
classiques de Minelli (Un Américain à Paris) ou Donen
(Funny Face).
| |
 |
|
|
De 1960 à 1980, Paris devient « polymorphe »,
aux dires des auteurs. C’est la « ville fantomatique »
des polars de Melville, Deray ou Verneuil, le « terrain
de jeu » des comédies de Gérard Oury ou encore le « Paris
naturaliste » de Pialat et Doillon. Bunuel, Ruiz ou Iosseliani
en profitent aussi pour réinventer la ville selon leurs désirs.
Dans les années 80, Beineix, Besson et Carax se réapproprient
Paris pour en donner une image plus moderne, assez irréelle
et onirique, loin des réalités communautaires et sociales
que le cinéma français des années 90 prendra en charge à travers
les films de Jean-Claude Brisseau, Malik Chibane, Thomas Gilou
ou Thomas Kassovitz. Inversement, Paris devient parallèlement
le théâtre des états d’âme de toute une génération de jeunes
cinéastes (cf les quêtes amoureuses des films de Christian
Vincent, Arnaud Desplechin ou Olivier Assayas…).
Synthèse d’un Paris onirique nostalgique d’un passé idéalisé
et d’une esthétique formelle travaillée, Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet clôt cette longue
série qui ne s’achèvera jamais, tant Paris demeure encore
aujourd’hui un puissant aimant pour les cinéastes du monde
entier, comme en témoigne très récemment le film de Tsai Ming-liang,
Et là-bas quelle heure est-il ?
On referme le livre avec l’envie pressante de se perdre à
nouveau dans les rues de Paris, ivre de ces souvenirs de cinéma.
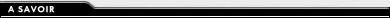 |
|
|
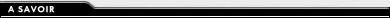 |
|
N. T. Binh :
né en 1958, il est membre du comité de rédaction
de la revue Positif et chroniqueur au magazine
Zurban. Il est également enseignant de cinéma,
producteur, réalisateur de documentaires et auteur
de livres sur Mankiewicz, Lubitsch, Bergman et
sur le cinéma britannique (codirection d’ouvrage).
Franck Garbarz
: né en 1969, il est membre du comité de rédaction
de la revue Positif. Producteur d’émissions de
télévision et de radio, il enseigne le cinéma
(HEC, ESRA, Université de Rennes) et est l’auteur
d’une monographie sur Krzysztof Kieslowski.
|
|
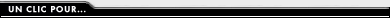 |
|
Titre : Paris au cinéma, la vie rêvée de la capitale
de Méliès à Amélie Poulain
Auteurs : N. T.
Binh, Franck Garbarz
Editeur :
Parigramme
Format : 23,4x27cm
Nombre de pages :
224
Prix : 45 €
|
|
|