L’ouvrage compte-rendu du festival international
du film de Locarno consacré aux rapports du jazz et du cinéma
fait sien le titre double d’un film de Bob Fosse, au moment
où un hommage est rendu au réalisateur et chorégraphe à travers
un spectacle donné au théâtre du châtelet, reprenant quelques-unes
des meilleures chorégraphies de celui qui a fait de la comédie
musicale un art mélancolique et cruel, entre swing classique
endiablé et modernité morbide. Pourtant, une seule occurrence
est faite à ce grand amateur de jazz, danseur devant l’éternel,
car cet All That Jazz s’intéresse plus au filmage de
la musique-action que de la musique-mouvement…
| |
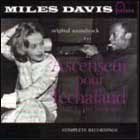 |
|
|
Entre historique et esthétique, All
That Jazz propose un tour d’horizon des liens qui unissent
le jazz et le cinéma, deux arts qui ont à peu de choses près
le même âge, et qui se sont autant servis que desservis. D’abord,
comment filmer le jazz ? Musique éminemment basée sur l’improvisation,
quand elle n’est pas tout simplement free, alors que
le cinéma, quoi qu’on en dise, est un art de la technique contrôlée,
jazz et cinéma semblent être les frères ennemis, bataillant
pour une domination totale du spectateur. Alors que le cinéma
peut reléguer le jazz au rang de fond sonore (alliage paradoxal,
comme le dit Alain Corneau lors de l’entretien qu’il a consacré
Baptiste Piégay, tant il s’agit d’une musique forte), le jazz
semble pouvoir avaler les prouesses cinématographiques, et même
les dépasser lorsque la caméra se fait humble et laisse au musicien
le loisir de développer ce qui jamais ne peut être connu d’avance.
Le jazz, comme le cinéma, est un art du temps, qui demande un
abandon total du réalisateur comme du spectateur. Ce rapport
du filmeur et du filmé, Jean-Louis Comolli et Philippe Carles
le sondent dans leur très bel article « L’œil contrôle,
le corps écoute (filmer le free) », en se posant des questions
qui restent sans réponse, mais qui font indubitablement progresser
notre réflexion sur le filmage des sons, ou comment rendre concrète
une entité invisible… Carles et Comolli nous transmettent leurs
impressions et leurs interrogations de spectateurs et d’amateurs
de jazz, leur perception d’un corps déchiré par la musique,
d’une musique viscérale. Avec cet article, le jazz et le cinéma
passent dans le camp de la sensation. Seule vraie réflexion
théorique, « L’œil contrôle, le corps écoute » est
un pendant nécessaire aux études historiques et politiques qui
l’entourent.
Le jazz charrie avec lui tout un imaginaire et un vocabulaire
passé au crible au long de neuf articles.
|