Voilà le cœur du problème, car ce regard
mit des années à se mettre en place, tandis que son objet
ne cessait de muer. La durée de vie des phénomènes « tendance »
à Tokyo se mesure au chronomètre, et les otakus ont depuis
laissé leur place aux « freetas » (free time arbeito
/ les boulots à temps partiel ), ainsi qu'à une génération
se consacrant au volontariat dans des ONG.
Vint s'ajouter par la suite, mon malaise
à la lecture de certaines critiques de films contemporains
du Japon, des Cahiers a Libé, des Inrocks à Technikart,
qui voyaient des clans et des cultes d'otakus partout dans
la société nippone. Cette paresse ethno-sociologique, ces
lieux communs, durent depuis bientôt dix ans, depuis la
« renaissance » de l'industrie cinématographique
de ce pays.
J'eus récemment l'occasion de discuter
d'Otaku: dix ans après, avec Beineix lors de son
passage à Tokyo pour la promo de Mortel Transfert.
Beineix, comme Carax, continue de bénéficier d'un engouement
du public japonais qui ne se dément pas; au dernier festival
du film français de Yokohama en juin 2001, le premier film
a afficher complet fut Mortel... Il reste lucide,
serein, tout a travaillant à faire le deuil de son succès
en France.Mais avant même de nous parler, je pus constater,
qu'à l'image de son Otaku, l'imaginaire japonais
tourne selon lui largement autour au sexe. A la fin d'une
projection de son dernier film à l'Institut Franco-Japonais
de Tokyo, Beineix monta sur scène pour répondre à quelques
questions; une jeune « actrice » Japonaise se
risqua à quelques mots en français, puis en japonais, avant
de terminer en anglais pour lui dire qu'elle voulait jouer
dans ses films. Beineix lui demanda si elle connaissait
bien ses films, si elle mesurait bien la part charnelle
des rôles qu'il offre aux comédiennes. La jeune femme dans
la salle affirma que cela allait de soi. Le réalisateur,
tout sourire, de lui répondre que la discussion pouvait
s'ouvrir.
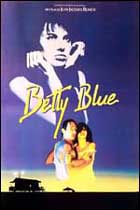 |
|
|
|
Plus tard dans la soirée, je lui faisais
part de mon « hostilité » face à Otaku,
bien que je garde de bons souvenirs de Diva (que
Beineix qualifiait de film otaku avant l'heure) et de La
Lune dans le Caniveau. J'ai souvent souligné par le
passé, la part malsaine de cette réalisation, à quel point
le montage etait tendancieux, la sélection des témoins interrogés
convenue et condamnable. Un peu comme si la chaîne NHK venait
faire un portrait de la jeunesse en France à partir des
émissions « jeunes » de M6 (dont les vieux soaps
« école de stylisme » sont importés au Japon...).
Beineix me demanda si j'avais vu la version 52 minutes ou
celle de 3 heures, que je ne connais pas. Notre conversation
fut interrompue par l'arrivée inattendue des sœurs Kanoshima,
des sœurs starlettes de la télé et de la pub, venues se
faire photographier avec le real de Betty Blue. Celles-ci
se rendent à toutes les réceptions, dans l'espoir de décrocher
un rôle dans une production internationale; Brett Sadler,
coincé entre les plastiques revues et corrigées des sœurs
Canon (ce sont leurs nouveaux décolletés qui les lancèrent,
cet imaginaire dont parle Beineix) pensait pouvoir faire
quelque chose pour elles lors de Rush Hour 3...
